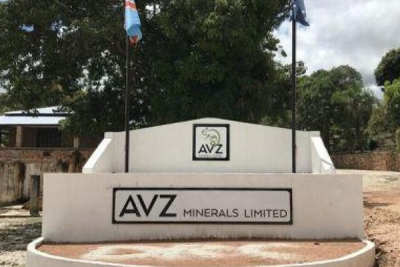Mines (257)
Buenassa cherche « un appui financier pour l’acquisition d’un actif minier local stratégique dans la région du Katanga, actuellement en vente », a annoncé, le 12 janvier 2026, son président-directeur général, Eddy Kioni, à la suite d’une rencontre avec le nouveau directeur général de UBA en République démocratique du Congo (RDC), Michael Kayembe. Selon une source proche de l’entreprise congolaise, l’actif en question est la société minière Chemaf. Selon Bloomberg, Buenassa a formellement notifié, en novembre dernier, son intérêt pour ce producteur de cuivre et de cobalt, dont l’avenir est suivi de près en raison de ses actifs et de son positionnement dans la compétition autour des minerais critiques en RDC.
Pour le PDG de Buenassa, cette acquisition permettrait « d’accélérer l’intégration verticale : de l’extraction au raffinage, au négoce et au stockage stratégique », en sécurisant l’approvisionnement de la raffinerie pour « plus de 20 ans ». Le dirigeant affirme que ce schéma renforcerait la résilience opérationnelle et transformerait Buenassa « d’un projet industriel greenfield (à construire) en un acteur minier opérationnel majeur ». L’enjeu est clair : passer d’un projet industriel à construire à une entreprise disposant d’une production minière, capable d’alimenter une raffinerie et de structurer un modèle intégré sur la chaîne de valeur.
Cette logique distingue Buenassa de plusieurs offres concurrentes, davantage structurées autour d’un contrôle financier et commercial de Chemaf. À titre de comparaison, la Gécamines, autre prétendant congolais, propose d’acquérir la compagnie minière pour la revendre et ne conserver qu’une participation maximale de 25 %, rapporte Bloomberg. Et grâce à sa filiale Gécamines Trading, elle commercialiserait la production correspondant à sa participation aux États-Unis, conformément à l’engagement pris par la RDC dans le cadre de l’accord stratégique signé avec les États-Unis en décembre dernier.
Actif vital
À l’inverse, l’approche de Buenassa vise un objectif explicitement industriel : sécuriser une matière première pour un projet de raffinage en RDC, et non seulement capter un flux de production à exporter. Ce qui inscrit le projet dans la vision du gouvernement congolais, qui insiste désormais sur la transformation locale des minerais. Sauf que les détails de son offre restent inconnus. La Gécamines, pour sa part, prévoirait un ticket d’un peu moins d’un million de dollars, un audit de la compagnie, puis un plan de paiement de ses dettes, que des sources médiatiques chiffrent à 900 millions de dollars. Une partie serait détenue par Trafigura, qui a arrangé un prêt de 600 millions de dollars en 2022 pour financer le développement de la mine de Mutoshi à Kolwezi.
En réalité, l’acquisition d’un actif d’extraction apparaît comme vitale pour le projet Buenassa. Elle permettrait d’améliorer sa bancabilité en apportant un actif susceptible de garantir le remboursement des ressources nécessaires au financement de la construction de la raffinerie. Jusqu’ici, l’entreprise n’a pu sécuriser qu’une subvention publique de 3,5 millions de dollars auprès du Fonds de promotion de l’industrie (FPI). Cela a notamment permis de réaliser une étude de cadrage (scoping study).
Cette dernière évalue le coût de la première phase du projet à 700 millions de dollars, selon un document consulté par Bankable. À ce stade, l’usine devrait produire annuellement 30 000 tonnes de cathodes de cuivre et 5 000 tonnes de sulfate de cobalt. Le coût de la deuxième phase est estimé à 2 milliards de dollars. À ce stade, la production passerait à 120 000 tonnes de cuivre et 20 000 tonnes de cobalt par an. Ces données doivent encore être affinées.
Équation difficile
Le calendrier indicatif actualisé prévoit désormais une étude de préfaisabilité au début de 2026 et une étude de faisabilité au deuxième trimestre 2027, alors que le closing financier est projeté au troisième trimestre 2027 et que le début de la production n’est pas attendu avant 2029, contre 2027 auparavant.
Pour financer cette stratégie, Buenassa met en avant une approche « à plusieurs niveaux », combinant banques commerciales africaines, institutions régionales de financement du développement, institutions financières locales, partenaires internationaux stratégiques « menés par les États-Unis » et l’État congolais, qui détient depuis juin 2025 une participation de 10 % dans le capital de l’entreprise de projet Buenassa Ressources. De la réunion avec UBA, il ressort que l’objectif est de bâtir une architecture de financement capable de soutenir à la fois la construction de la raffinerie et l’opération d'acquisition de l’actif d’extraction.
Mais l’accès à Chemaf s’annonce difficile. « Nous ne donnerons pas de chance à quelqu’un d’autre que nous », avait déclaré, fin 2024, Guy-Robert Lukama, président du conseil d’administration de la Gécamines, cité par Reuters. Il faut dire que, sur ce dossier, l’entreprise publique est en position de force : elle détient le permis sur lequel Chemaf développe le projet Mutoshi. Mais l’État, unique actionnaire de la Gécamines — et actionnaire à 10 % de Buenassa ainsi qu’à 5 % de Chemaf — devra trancher en tenant compte des orientations de sa politique minière.
D’ailleurs, à bien y regarder, un rapprochement stratégique entre la Gécamines et Buenassa — qui se profilent comme deux véhicules souverains de la RDC pour la valorisation de son patrimoine minier dans les filières cuivre et cobalt — constitue une option. Les positionnements de l’entreprise publique et de sa compatriote privée paraissent même complémentaires sur la chaîne de valeur. Au regard de l’intérêt d’entreprises américaines pour Chemaf, l’idée d’un consortium RDC (Gécamines, Buenassa…)–États-Unis est présentée, par des acteurs proches du dossier, comme l’alternative la plus réaliste, compte tenu des défis financiers, opérationnels et de sécurité des sites. Une telle perspective s’inscrirait dans le prolongement du partenariat stratégique RDC–États-Unis.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Cathodes de cuivre : Chemaf prévoit d’arrêter sa production en novembre 2025
La Gécamines prête à investir près d’un million $ pour racheter Chemaf et assumer le passif
Raffinerie de cuivre-cobalt : l'Americain Hartree se positionne sur le projet Buenassa
Cuivre de TFM : Gécamines veut orienter 100 000 tonnes vers les États-Unis en 2026
La République démocratique du Congo (RDC) prévoit de renforcer le contrôle de ses exportations minières afin d’améliorer la mobilisation des recettes. Dans un rapport publié en janvier 2026, le Fonds monétaire international (FMI) relaie l’objectif des autorités d’obtenir une évaluation plus fiable « des volumes, de la teneur minérale et de l’humidité des exportations », des paramètres déterminants pour la valorisation des produits et l’assiette des prélèvements.
Le document souligne le coût budgétaire de contrôles jugés insuffisants : « Des études montrent que notre pays perd près de la moitié de ses recettes minières potentielles en raison de contrôles insuffisants sur les volumes et la teneur en métaux de valeur ». Pour corriger ces faiblesses, les autorités indiquent vouloir accroître le recouvrement des recettes minières « sur la base du principe consistant à minimiser les contacts humains ».
L’une des mesures annoncées consiste à déployer, d’ici mars 2026, des outils techniques destinés à fiabiliser le contrôle physique des flux à l’exportation, « par la mise en place de bascules de pesage pour camions et de mécanismes de contrôle qualité informatisés et non intrusifs ».
Cette réforme s’accompagne du renforcement d’un dispositif d’analyse. Le FMI rapporte que les autorités entendent « obtenir l’approbation du ministère des Mines d’ici janvier 2026 » afin de « rendre opérationnel un laboratoire d’analyse minérale sous contrat avec l’administration fiscale (DGI) ».
L’objectif affiché est de disposer d’une capacité technique permettant d’appuyer les contrôles et, plus largement, de renforcer la conformité. Le rapport évoque ainsi un effort visant à améliorer l’évaluation des caractéristiques des exportations (dont l’humidité et la teneur), éléments essentiels pour apprécier la valeur déclarée et les obligations fiscales correspondantes.
Au-delà du seul segment minier, le document met en avant l’enjeu de modernisation des administrations financières et des contrôles. Il note que les audits fiscaux, à ce stade, « produisent moins de 15 % de leur rendement potentiel », dans un contexte où les autorités veulent renforcer le recoupement des données par l’automatisation et la numérisation.
Dans l’ensemble, la démarche présentée par le FMI combine donc un renforcement des contrôles physiques et analytiques des flux miniers à l’exportation, et une orientation vers des dispositifs davantage automatisés, avec pour finalité annoncée l’amélioration de la fiabilité des contrôles et la sécurisation des recettes.
Boaz Kabeya
Lire aussi :
Douanes : des scanners attendus en 2026 pour renforcer les contrôles en RDC
La compagnie australienne AVZ Minerals a annoncé, le 15 janvier 2026, la réception de la totalité des fonds promis l’année précédente par son partenaire Suzhou CATH Energy Technologies. Il s’agit d’une facilité de 20 millions de dollars que l’entreprise chinoise a accepté de mettre à la disposition de son partenaire australien, qui revendique des droits d’exploitation sur le gisement de lithium de Manono, dans la province du Tanganyika, en République démocratique du Congo (RDC).
Lors de l’annonce de cette facilité, un an plus tôt, AVZ indiquait que ces fonds devaient financer, sur les 12 mois suivants, ses besoins en fonds de roulement et ses activités, y compris celles liées au litige qui l’oppose à l’État congolais sur ce projet. En débloquant les fonds, CATH reste ainsi aux côtés d’AVZ.
L’accord signé en janvier 2025 accorde à CATH plusieurs avantages en cas de succès des revendications d’AVZ sur le gisement de Manono. L’entreprise chinoise aurait notamment le droit d’acquérir 100 % de la production de lithium pendant cinq ans, ou jusqu’au remboursement des dépenses d’AVZ qu’elle aura financées. CATH dispose par ailleurs du droit d’acheter une participation indirecte de 30,5 % dans le projet. Mais l’avenir du dossier reste incertain.
Manono est le plus grand gisement de lithium identifié à ce jour en RDC. AVZ Minerals y a mené des travaux d’exploration sur plusieurs années, dans le cadre d’une coentreprise avec la société publique congolaise Cominière. Cette dernière a ensuite mis fin au partenariat, avant de s’associer en 2023 avec le chinois Zijin Mining pour développer le même projet. AVZ a intenté plusieurs actions devant des tribunaux internationaux pour contester ces évolutions autour de la propriété du projet, mais aucune décision définitive n’a encore été rendue.
Dans ce contexte, un autre acteur est entré en scène : KoBold Metals. À la faveur du rapprochement entre Kinshasa et Washington autour de nouveaux investissements américains dans le secteur minier congolais, cette start-up californienne a signé, en juillet dernier, un « accord de principe » avec le gouvernement congolais pour l’exploration minière en RDC. Elle a par la suite obtenu sept permis de recherche minière, dont quatre situés sur le territoire de Manono.
Selon cet accord de principe, il revient à KoBold de trouver une issue au différend entre AVZ et l’État congolais. Deux mois auparavant, KoBold et AVZ avaient annoncé la conclusion d’un accord-cadre prévoyant la cession, par AVZ, de ses intérêts commerciaux dans le gisement de Manono à une « juste valeur ». Sauf que la compagnie australienne — qui avait gelé la procédure d’arbitrage engagée contre la RDC pour créer « un climat propice à des discussions » susceptibles de déboucher sur un règlement à l’amiable — a entre-temps annoncé sa reprise.
Zijin Mining, qui a obtenu en septembre 2024 un permis d’exploitation sur la zone revendiquée par AVZ, avait annoncé un début de production en 2026, mais n’a fourni que peu de mises à jour sur l’évolution des travaux de construction de la mine.
PM avec l’Agence Ecofin
Lire aussi:
Manono : la phase 3 de la centrale hydroélectrique de Mpiana-Mwanga prévue à 108 MW
Lithium de Manono : l’Américain KoBold Metals obtient plusieurs permis de recherche
Lithium de Manono : l’Américain Kobold signe un accord de principe avec Kinshasa
Lithium de Manono : AVZ relance l’offensive judiciaire, l’offre de KoBold fragilisée
La mine de zinc de Kipushi, en République démocratique du Congo (RDC), codétenue par Ivanhoe Mines (62 %) et la Gécamines (38 %), a quadruplé sa production en 2025, à 203 168 tonnes de concentré, contre 50 307 tonnes en 2024. Ces chiffres ressortent des résultats opérationnels annuels publiés le 15 janvier 2026 par Ivanhoe Mines, opérateur du site. La performance est conforme aux objectifs du groupe, qui visait une production comprise entre 180 000 et 240 000 tonnes.
Cette montée en puissance s’explique par des travaux d’ingénierie lancés en septembre 2024 afin d’augmenter de 20 % le débit du concentrateur de Kipushi, chargé du traitement du minerai. Le programme d’optimisation s’est achevé début août 2025, permettant à la mine d’enregistrer une hausse significative de la production au second semestre.
Au troisième trimestre, la mine a livré 57 200 tonnes, puis 61 444 tonnes au dernier trimestre, nettement au-dessus des 42 736 tonnes et 41 788 tonnes enregistrées respectivement aux premier et deuxième trimestres 2025. Avec les niveaux atteints ces derniers mois, Kipushi se place au cinquième rang des plus grandes mines de zinc au monde, assure Ivanhoe.
Pour 2026, l’ambition est de porter la production à un volume compris entre 240 000 et 290 000 tonnes. Maintenir des opérations stables sera l’un des défis d’Ivanhoe, alors que le site reste affecté par l’instabilité du réseau électrique congolais. Pour s’en prémunir, la compagnie indique avoir renforcé les capacités des générateurs de secours au quatrième trimestre 2025.
Emiliano Tossou, Agence Ecofin
Lire aussi :
Zinc : Kipushi s’approche de son objectif annuel avec plus de 137 000 tonnes en neuf mois
Zinc : après des difficultés, la mine de Kipushi en passe d’intégrer le top 4 mondial
Comme promis en novembre dernier lors du Makutano 2025, le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a dévoilé, lors de la 74ᵉ réunion ordinaire du Conseil des ministres du 9 janvier 2026, les contours du projet d’exploitation du fer en République démocratique du Congo (RDC).
Selon le compte rendu de cette réunion, le projet, présenté comme « une inflexion stratégique majeure » dans le modèle extractif du pays — concentré depuis plus de 100 ans sur le cuivre et le cobalt — est dénommé Mines de fer de la grande Orientale (Mifor). Il repose sur les réserves de l’ancienne province Orientale, aujourd’hui divisée en Ituri, Haut-Uélé, Bas-Uélé et Tshopo. Elles sont estimées entre 15 et 20 milliards de tonnes, avec une teneur moyenne supérieure à 60 %, indique le document, sans préciser la méthodologie utilisée pour ces estimations.
Selon la présentation du ministre des Mines, le projet Mifor doit être développé en plusieurs phases. La première prévoit une capacité de production de 50 millions de tonnes par an, progressivement extensible jusqu’à 300 millions de tonnes par an. Le schéma présenté ne se limite pas à l’extraction : il inclut des unités de transformation locale ainsi qu’un corridor logistique dit « multimodal », combinant notamment un chemin de fer lourd, la voie fluviale et une connexion au port en eaux profondes de Banana.
D’après la même source, l’investissement initial de la première étape est évalué à 28,9 milliards de dollars américains. Sur une projection de 25 ans, le ministre avance un chiffre d’affaires cumulé de 679,3 milliards de dollars et un « cash-flow net » de 308,2 milliards de dollars, sur la base « d’hypothèses prudentes de marché ». Pour l’État, le document évoque des « retombées substantielles et diversifiées », sans en préciser le montant.
Actuellement, la tonne de fer s’échange autour de 105 dollars. Mais avec l’entrée en production, annoncée en novembre dernier, de la gigantesque mine de Simandou en Guinée, les cours pourraient être tirés vers le bas à moyen terme. Si le calendrier de ce projet est respecté, cette mine pourrait produire jusqu’à 120 millions de tonnes de minerai dès 2028 et peser sur le marché.
À ce stade, le projet Mifor n’est toutefois pas encore entré dans une phase d’engagement formel. Sans citer de noms, le compte rendu souligne l’intérêt d’investisseurs institutionnels internationaux disposant de capacités reconnues de structuration et de financement de projets macroéconomiques. Pour le gouvernement, cela constitue un « signal favorable de bancabilité et de crédibilité internationale », « sans préjuger des décisions souveraines à venir » et « sans créer d’engagement juridique à ce stade ». Autrement dit, les modalités exactes de financement, les partenaires retenus et le calendrier de mise en œuvre n’ont pas été officialisés.
Dans l’immédiat, l’exécutif a décidé la mise en place d’une gouvernance dédiée. Le Conseil des ministres a acté la création d’une commission interministérielle élargie chargée d’assurer le pilotage stratégique, la coordination et la structuration progressive du projet.
Boaz Kabeya
À travers Gécamines Trading, sa nouvelle filiale dédiée au trading des minerais, Gécamines veut orienter vers les États-Unis une partie de la production de cuivre de Tenke Fungurume Mining (TFM), contrôlée à 80 % par le groupe chinois CMOC. Pour ce faire, l’entreprise publique congolaise annonce avoir décidé d’utiliser, pour la première fois, son droit contractuel d’acheter la part de production correspondant à sa participation de 20 % dans cette mine afin de la revendre aux États-Unis. Elle chiffre ce volume à 100 000 tonnes pour l’année 2026.
«Cette première opération de commercialisation constitue le prolongement et le développement du dispositif d’offre compétitive des productions des partenariats de Gecamines, dispositif mis en place depuis 2023 et exécuté jusqu’à présent avec succès », a indiqué le président du Conseil d’administration de Gécamines, Guy-Robert Lukama, cité dans le communiqué de l’entreprise.
L’idée de commercialiser elle-même la part de production correspondant à sa participation dans les coentreprises minières découle, selon Gécamines, de la volonté de contourner la pratique des prix de transfert utilisée par plusieurs opérateurs. Cette pratique consiste à vendre la production à bas prix à une société liée, réduisant d’autant les dividendes versés à Gécamines et les recettes minières reversées à l’État. Avec cette démarche, l’entreprise espère une meilleure valorisation des produits congolais, une augmentation de la base taxable pour l’État et une diversification des acheteurs, renforçant l’indépendance commerciale du pays.
« Nous sommes heureux de cette première opération qui concrétise un travail mené depuis plus d’une année désormais pour renforcer la position de la République Démocratique du Congo sur l’échiquier mondial des matières premières et concrétiser la volonté de l’Etat congolais d’asseoir sa souveraineté sur son sous-sol », a précisé la directeur général de Gécamines, Placide Nkala Basadilua, repris dans le même communiqué. À terme, la compagnie publique ambitionne des droits de vente pouvant atteindre 500 000 tonnes de cuivre et 40 000 tonnes de cobalt, confirmant sa volonté de redevenir un acteur global du marché des matières premières critiques.
Accord stratégique
Avant de décider d’exercer son droit d’achat, Gécamines dit avoir réalisé, fin 2025, une consultation de marché. Selon nos informations, à l’issue de cette consultation, plusieurs acteurs américains se sont portés acquéreurs des 100 000 tonnes de cuivre, à des conditions jugées avantageuses pour Gécamines. Il faut dire que le cuivre a signé une année 2025 exceptionnelle, avec une hausse de prix de 44 % et un record à 12 960 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME). Selon les analystes, la dynamique resterait favorable en 2026.
L’opération permet également à la RDC de mettre en œuvre les engagements pris dans l’accord stratégique signé le 4 décembre 2025 à Washington avec les États-Unis. Selon le texte, « la RDC et ses entreprises publiques utiliseront leurs droits de commercialisation liés à la participation et aux contrats pour fournir un accès à l’offtake aux personnes américaines et alliées ». Ce dispositif oblige Gécamines, ou toute autre entreprise publique, à proposer en premier lieu ses volumes commercialisables aux sociétés américaines avant tout autre acheteur, sous réserve de « conditions commerciales comparables », afin de garantir une conformité aux prix internationaux.
Gécamines Trading, qui porte l’opération, est une joint-venture mise en place en partenariat avec le groupe genevois Mercuria Energy Trading. Chargée de commercialiser le cuivre, le cobalt et d’autres minerais critiques, comme le germanium ou le gallium, provenant du sous-sol congolais, elle est également soutenue par la US International Development Finance Corp (DFC). L’agence publique américaine, qui appuie le développement d’entreprises américaines sur les marchés émergents, dit même avoir émis une lettre d’intention en vue d’un « investissement en actions » dans cette joint-venture. Objectif : « sécuriser les chaînes d’approvisionnement américaines en minéraux stratégiques », souligne-t-elle.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Ventes des minerais critiques : vers une coentreprise Gécamines-Mercuria-DFC
Minerais critiques, sécurité, fiscalité… : ce que prévoit l’accord RDC–États-Unis
Gécamines : Lukama vise une intégration à la marocaine, de l’extraction à la chimie
Cuivre : Mercuria renforce ses approvisionnements depuis la RDC grâce à un accord avec ERG
À l’issue de la réunion annuelle d’évaluation tenue le 9 janvier 2025, l’entreprise publique DRC Gold Trading a annoncé la poursuite de son expansion sur le territoire national, avec l’ouverture imminente d’une succursale à Mbujimayi et d’une autre à Kinshasa d’ici fin mars 2026. Cette stratégie vise à atteindre l’objectif fixé : disposer de dix sièges opérationnels à travers le pays, afin d’atteindre un volume compris entre 15 et 18 tonnes d’or artisanal et des recettes d’exportation de plus de 2 milliards de dollars.
À ce stade, l’entreprise compte cinq succursales pleinement opérationnelles, auxquelles s’ajoute celle de Bukavu, non fonctionnelle depuis l’occupation de la ville par les rebelles de l’AFC/M23 en mars 2025. L’atteinte de l’objectif haut de gamme, soit 18 tonnes, constitue un défi majeur, d’autant que depuis son entrée en service début 2023, DRC Gold Trading SA a exporté environ 10 tonnes d’or artisanal.
Une difficulté supplémentaire réside dans l’incertitude entourant la contribution de la succursale de Bukavu cette année, alors qu’elle représentait à elle seule plus de 90 % des exportations légales d’or artisanal entre 2023 et 2024, avec, en 2023, une moyenne mensuelle de plus de 420 kg en provenance du Sud-Kivu.
L’entreprise publique a toutefois ouvert une succursale à Kindu, dans le Maniema, qui compense partiellement le manque à gagner du Sud-Kivu. Avec une moyenne d’environ 114 kg d’or artisanal exporté chaque mois, cette province est devenue la première zone exportatrice du pays. À la fin du troisième trimestre 2025, elle représentait 34 % des exportations nationales d’or artisanal, pour un total de 683,67 kg, selon les données de la Cellule technique de coordination et de planification minière.
Timothée Manoke
Lire aussi :
Or : Morgan Stanley projette l’once à 4 800 $ d’ici le 4ᵉ trimestre 2026
Or artisanal : le Maniema devient le premier centre d’exportation légale en RDC
Exportations d’or artisanal : 2025 démarre mal pour la RDC après une chute de 66 % en 2024
L’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) a formalisé une décision majeure touchant directement la chaîne d’approvisionnement des entreprises minières en République démocratique du Congo. Dans une décision officielle rendue publique le 7 janvier 2026, le régulateur réserve désormais la fourniture de l’acide sulfurique, des réactifs chimiques et d’intrants assimilés aux seules entreprises de sous-traitance agréées, conformément à la loi n°17/001 relative à la sous-traitance dans le secteur privé.
Dans ce document, l’ARSP précise que la fourniture d’acide sulfurique, de chaux, de réactifs de flottation, d’extractants et d’autres produits chimiques utilisés dans le traitement des minerais constitue une activité de sous-traitance à part entière. À ce titre, elle ne peut plus être exercée directement par les sociétés minières ni par des entreprises non enregistrées dans le répertoire de l’ARSP.
L’ARSP justifie sa décision par la persistance de mécanismes de contournement de la loi sur la sous-traitance, qui auraient permis à des opérateurs non éligibles de capter un segment stratégique du secteur minier. Le régulateur rappelle que ces pratiques portent atteinte à l’objectif de la loi : garantir une participation effective des entreprises congolaises aux marchés générés par l’activité minière.
Désormais, toute société minière est tenue de s’approvisionner en acide et en réactifs exclusivement auprès de sous-traitants agréés par l’ARSP, sous peine de sanctions administratives prévues par les textes en vigueur.
Le choix de l’ARSP de cibler spécifiquement le marché de l’acide et des réactifs s’explique par leur rôle central dans les procédés de traitement des minerais, notamment du cuivre et du cobalt. Ces produits sont utilisés dans les procédés de lixiviation, qui permettent d’extraire les métaux des minerais.
Jusqu’ici, ces intrants étaient majoritairement fournis par des acteurs étrangers ou intégrés aux grandes sociétés minières, ce qui limitait l’accès des fournisseurs locaux et justifie l’orientation de la régulation vers les sous-traitants éligibles.
Cette décision s’inscrit dans la stratégie nationale de promotion du contenu local et de renforcement des PME congolaises. Elle vise à intégrer davantage les entreprises nationales dans la chaîne de valeur du secteur minier et à créer des emplois locaux.
Boaz Kabeya
Lire aussi :
Sous-traitance : Rawbank, l’ARSP et le FOGEC lancent des prêts jusqu’à 1 million $
Sous-traitance en RDC :un contrôle annoncé pour assainir un marché de 8,5 milliards $
Hydrocarbures: les sous-traitants désormais soumis à un agrément ministériel en RDC
Un nouveau cadre légal pour ancrer les Congolais dans les chaînes de valeur industrielles
Rio Tinto et Glencore ont confirmé cette semaine être en discussions préliminaires concernant une possible fusion de certaines, voire de l’ensemble, de leurs activités. Les deux groupes insistent sur le caractère exploratoire de ces échanges et soulignent qu’aucune offre ferme n’a été formulée à ce stade, ni sur le principe, ni sur les modalités d’une éventuelle transaction.
L’évolution de ces discussions est suivie de près en République démocratique du Congo (RDC), où Glencore contrôle deux importantes mines de cuivre et de cobalt : Kamoto et Mutanda, détenues respectivement à 70 % et 95 % par la multinationale suisse. Leurs permis expirent respectivement en 2039 et 2037. Bien qu’en recul de 7 % et 10 % par rapport à 2023, ces deux sites ont produit 224 500 tonnes de cuivre et 35 100 tonnes de cobalt en 2024.
Dans leurs communications respectives, les deux entreprises précisent qu’il n’existe aucune certitude quant à l’aboutissement de ces discussions. Elles rappellent également que toute opération éventuelle resterait soumise à un cadre réglementaire strict.
Selon Glencore, le scénario actuellement envisagé consisterait en son acquisition par Rio Tinto, via un schéma d’arrangement approuvé par un tribunal, un mécanisme fréquemment utilisé pour ce type d’opérations au Royaume-Uni. Rio Tinto confirme, de son côté, la tenue de discussions préliminaires et indique se réserver la possibilité, le cas échéant, d’ajuster la forme et la composition de la contrepartie d’une éventuelle offre.
Sur le calendrier, le cadre est désormais clairement fixé. Rio Tinto a jusqu’au 5 février 2026, à 17 h (heure de Londres), pour annoncer soit une intention ferme de formuler une offre, soit son absence d’intention de le faire.
Marché favorable au cuivre, volatil pour le cobalt
« La structure d’une éventuelle fusion entre ces deux groupes (Rio Tinto et Glencore, NDLR) reste incertaine et serait probablement complexe, mais nous estimons qu’il existe une voie vers une création de valeur significative pour les deux parties », ont commenté des analystes de Jefferies, cités par Reuters. Selon l’agence de presse, l’opération pourrait néamoins donner naissance « au plus grand groupe minier mondial, avec une capitalisation boursière combinée proche de 207 milliards de dollars ».
Ces discussions surviennent dans un contexte particulier. Le cuivre a signé une année 2025 exceptionnelle, avec une hausse de prix de 44 % et un record à 12 960 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME), porté par un dollar plus faible, la demande liée à l’intelligence artificielle et aux énergies renouvelables, ainsi que des perturbations minières. La dynamique reste favorable en 2026, selon les analystes.
Pour le cobalt, l’embargo sur les exportations imposé par la RDC a provoqué une hausse des prix de plus de 100 %, à 53 355 dollars la tonne au 31 décembre 2025. Mais le marché demeure exposé aux cycles de surproduction et à l’évolution technologique des batteries.
Dans ce paysage, la consolidation apparaît de plus en plus comme un levier pour sécuriser des volumes, mutualiser des investissements lourds et renforcer la résilience des groupes face à des cycles de marché devenus plus volatils. À titre d’illustration, le canadien Teck Resources et le britannique Anglo American ont été cités parmi les acteurs engagés dans des discussions de consolidation. Si elle se concrétise, cette opération pourrait créer l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de cuivre, avec une capitalisation boursière de plus de 50 milliards de dollars.
Pierre Mukoko avec l’Agence Ecofin
Lire aussi :
Cobalt : la RDC prolonge jusqu’au 31 mars 2026 les quotas d’exportation de 2025
Cuivre : la tonne frôle les 13 000 $ à Londres, sur fond d’inquiétudes
Cuivre et cobalt de Mutanda : les réserves « mesurées » de Glencore estimables à 72 milliards $
Cuivre et cobalt : Glencore dément tout projet de vente d’actifs en RDC, mais…
La République démocratique du Congo (RDC) avance vers la validation de sa stratégie nationale dédiée aux minéraux et métaux critiques. Le ministère des Mines a lancé, le 7 janvier 2026 à Lubumbashi (Haut-Katanga), les travaux de validation du projet de stratégie.
Prévues pour s’achever le 8 janvier, ces sessions doivent notamment examiner les orientations liées à la promotion de la transformation locale, au développement d’une industrialisation durable, au respect des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), à la mobilisation des énergies propres, au renforcement des capacités humaines et technologiques, ainsi qu’à l’amélioration de la gouvernance du secteur et au partage des bénéfices avec les communautés locales.
Selon le ministère des Mines, le projet de stratégie a été élaboré par des experts congolais et africains, avec l’appui de Southern Africa Resources Watch (SARW), partenaire technique et financier du secteur minier congolais depuis près de vingt ans.
Le document ambitionne de doter le pays d’un cadre opérationnel consensuel, orienté vers la diversification économique, l’industrialisation, la création d’emplois et la valorisation des ressources minières nationales.
Le ministère précise que cette étape s’inscrit dans un processus plus large d’élaboration d’une feuille de route visant à repositionner la RDC comme un acteur industriel majeur dans la chaîne de valeur mondiale des minéraux et métaux critiques, essentiels à la transition énergétique et à l’industrialisation verte.
Dans un rapport publié le 20 mars par le Natural Resource Governance Institute (NRGI), intitulé « La République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique : transformer la richesse minière en levier de développement durable », les experts soulignent la nécessité pour la RDC de se doter d’un cadre stratégique cohérent afin de garantir une transition énergétique bénéfique aux populations.
Le rapport pointe notamment le déficit de coordination interinstitutionnelle, les conflits d’intérêts, la politisation de l’action publique et la faible inclusion des parties prenantes, des facteurs qui ont freiné l’émergence d’un cadre harmonisé entre les secteurs minier et énergétique.
La RDC demeure confrontée au défi de la transformation locale de ses ressources minières. D’après un rapport du réseau Publish What You Pay (PWYP), le pays dispose d’un potentiel significatif pour capter davantage de valeur ajoutée, dans un contexte marqué par une croissance soutenue de la demande mondiale en minerais stratégiques liée à la transition vers des économies à faibles émissions de carbone.
Ronsard Luabeya
Lire aussi :
Minerais de transition : la RDC appelée à élaborer une stratégie nationale
Minerais critiques : les réserves de la RDC estimées à 24 000 milliards $
More...
Dans son communiqué annonçant la première production d’anodes de cuivre de la nouvelle fonderie du complexe cuprifère de Kamoa-Kakula, Ivanhoe Mines, développeur du projet, associe cette mise en production à un investissement total de 1,1 milliard de dollars.
Dans une déclaration incluse dans ce document, le fondateur et co-président exécutif du groupe, Robert Friedland, indique que cette étape constitue « l’aboutissement d’un investissement de 1,1 milliard de dollars ».
Ce montant s’écarte de l’estimation qui avait été communiquée lors des phases initiales du projet. Dans un communiqué daté du 18 novembre 2021, Ivanhoe Mines indiquait que le coût en capital attendu se situait « dans la région de 700 millions de dollars » pour la fonderie, en précisant que ce financement devait provenir des flux de trésorerie de Kamoa-Kakula.
La compagnie n’a pas indiqué explicitement les raisons de l’écart entre l’estimation de 2021 et l’investissement annoncé en 2026. Mais il apparaît que le montant de 1,1 milliard de dollars intègre des coûts connexes, d’autant que le projet a été réalisé sur le même modèle que celui présenté en 2021 : une installation direct-to-blister, dotée d’une capacité nominale de 500 000 tonnes par an de cuivre blister, avec un sous-produit d’acide sulfurique et des standards d’émissions alignés sur ceux de la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale.
Pour produire les premières anodes de cuivre, il a non seulement fallu construire la fonderie, mais également installer un système d’alimentation électrique sans interruption. Selon Ivanhoe Mines, ce dispositif de 60 MW peut fournir jusqu’à deux heures d’alimentation instantanée de secours à la fonderie, la protégeant contre les fluctuations de tension du réseau national congolais.
Pour obtenir les 50 MW d’électricité propre qui ont permis la mise en service de la fonderie, il a par ailleurs fallu réhabiliter la turbine 5 du barrage hydroélectrique d’Inga II (178 MW). Un investissement que Kamoa Copper, propriétaire du complexe cuprifère, estime à 450 millions de dollars, en incluant les travaux de modernisation du réseau toujours en cours.
Boaz Kabeya
Lire aussi :
Cuivre : la fonderie de Kamoa-Kakula livre ses premières anodes pures à 99,7 %
Kamoa-Kakula : la demande électrique projetée à 347 MW d’ici fin 2028
La banque américaine Morgan Stanley anticipe un prix de l’or à 4 800 dollars l’once au quatrième trimestre 2026, selon une note publiée le 5 janvier 2026 et relayée par plusieurs médias internationaux. Cette projection, si elle se concrétise, dépasserait les sommets atteints fin 2025 par le métal jaune.
Dans son analyse, Morgan Stanley met en avant plusieurs facteurs susceptibles de soutenir le cours de l’or. La banque cite notamment la perspective de nouvelles baisses des taux d’intérêt, un changement de leadership attendu à la tête de la Réserve fédérale américaine, ainsi que la poursuite des achats d’or par les banques centrales et certains fonds d’investissement.
Des taux d’intérêt plus bas réduisent en effet le rendement des placements obligataires, ce qui tend historiquement à renforcer l’attrait de l’or — un actif qui ne génère pas de revenu mais est perçu comme une réserve de valeur.
La note mentionne également les récents événements au Venezuela comme un facteur susceptible de renforcer la position de l’or en tant que valeur refuge, sans toutefois les intégrer explicitement dans la construction de sa prévision chiffrée.
D’autres analystes encore plus optimistes
La projection de Morgan Stanley s’inscrit dans le prolongement d’un cycle haussier amorcé bien plus tôt que prévu. Dès octobre 2025, l’or avait franchi pour la première fois le seuil symbolique des 4 000 dollars l’once, prenant de vitesse les prévisions de plusieurs institutions financières.
Le métal précieux a ensuite atteint un record historique à 4 549,71 dollars l’once le 26 décembre 2025, et a terminé l’année sur une progression annuelle d’environ 64 %, sa meilleure performance depuis 1979, selon les données de marché.
Si Morgan Stanley s’attend à ce que la tendance haussière se poursuive en 2026, d’autres analystes sont encore plus optimistes. JP Morgan, Bank of America ou encore le cabinet Metals Focus ont précédemment évoqué la possibilité que le prix du métal jaune dépasse le seuil des 5 000 dollars l’once cette année.
Le marché est suivi de près par de nombreux pays producteurs, notamment en Afrique, où l’or constitue une source importante de revenus d’exportation et de recettes publiques.
Agence Ecofin
Lire aussi :
Mine d’or de Kibali : la production s’accélère, mais l’objectif annuel reste incertain
Or artisanal : le Maniema devient le premier centre d’exportation légale en RDC
La nouvelle fonderie du complexe cuprifère Kamoa-Kakula, situé dans la province du Lualaba et opéré par Kamoa Copper SA, a produit ses premières anodes de cuivre pur à 99,7 % le 29 décembre 2025. Ivanhoe Mines, développeur et actionnaire du projet, en a fait l’annonce le 2 janvier 2026. Il s’agit d’une avancée industrielle notable pour ce complexe minier, dont la montée en puissance est suivie de près par les observateurs du marché des métaux.
D’un coût annoncé de 700 millions de dollars, la fonderie vise une capacité nominale de traitement de 500 000 tonnes de concentré par an, ce qui en fait, selon Ivanhoe, la plus grande installation de ce type en Afrique. L’infrastructure permettra, à terme, de transformer sur place le concentré issu des trois unités de traitement du site minier.
En attendant sa pleine montée en régime, la compagnie prévoit que ses ventes de cuivre excéderont sa production annuelle, en raison de la commercialisation progressive de stocks antérieurs constitués avant l’entrée en service de la fonderie.
Jusqu’à 700 000 tonnes d’acide sulfurique par an
Le site produira également jusqu’à 700 000 tonnes par an d’acide sulfurique, un sous-produit utilisé dans l’industrie minière régionale et dont la demande s’est accrue depuis l’interdiction d’exportation imposée par la Zambie en septembre 2025. Les premières ventes ont d’ores et déjà été conclues, selon la compagnie.
Au-delà des chiffres, cette entrée en production concrétise un changement de paradigme industriel pour Kamoa-Kakula. Depuis sa mise en service en 2021, la mine exportait la majeure partie de son concentré de cuivre vers des fonderies situées hors du territoire congolais. Une partie — environ 35 % selon plusieurs sources concordantes — était également traitée localement à l’usine de Lualaba.
« Cette installation livrera les anodes de cuivre congolais de la plus haute qualité aux marchés internationaux, établissant une nouvelle référence mondiale en termes d’échelle, d’efficacité et de durabilité », a commenté l’homme d’affaires canado-américain Robert Friedland, l’un des dirigeants d’Ivanhoe Mines.
La construction d’une fonderie sur site s’inscrit dans une logique de valorisation locale formulée dès 2021 par la compagnie, afin de réduire les coûts logistiques — le volume de cuivre contenu par chargement étant plus élevé une fois transformé —, de sécuriser les débouchés et de diversifier ses sources de revenus.
D’après les dernières données disponibles, l’ensemble de la production d’anodes de la fonderie est déjà couvert par des contrats de vente à long terme, conclus avec les groupes chinois CITIC Metal et Zijin Mining, ainsi qu’avec le négociant suisse Trafigura.
Un marché sous tension
L’entrée en production de cette infrastructure survient dans un contexte de tensions persistantes sur l’offre mondiale de cuivre et d’anticipations haussières sur les prix. Le cours du métal rouge a affiché une tendance haussière en décembre et s’est même approché des 13 000 dollars la tonne sur le London Metal Exchange (LME) en fin de mois, porté par l’anticipation de droits de douane américains sur les importations de cuivre raffiné, ainsi que par les préoccupations sur l’approvisionnement.
Parmi les facteurs d’inquiétude figurent plusieurs incidents survenus en 2025, dont un séisme ayant affecté Kamoa-Kakula en mai dernier. Ce sinistre a conduit Ivanhoe à revoir à la baisse ses prévisions de production, désormais attendue à environ 420 000 tonnes en 2025 et 2026, contre plus de 500 000 initialement escomptées.
Dans ce climat, plusieurs analystes s’attendent à une poursuite de la hausse des prix au cours des prochains mois. Le groupe Citigroup estime que le cuivre pourrait dépasser 13 000 dollars la tonne d’ici le deuxième trimestre 2026 et anticipe une hausse de 2,5 % de la consommation mondiale finale sur l’année. Gregory Shearer, stratège métaux chez J.P. Morgan, considère que la conjonction entre « stocks disloqués » et « perturbations aiguës de l’offre minière » crée les conditions d’un marché haussier durable.
Cette dynamique confère à l’entrée en production de la fonderie de Kamoa-Kakula une signification particulière, tant pour les actionnaires que pour le pays hôte, en offrant un levier économique supplémentaire.
Pour rappel, le complexe minier est détenu à 39,6 % par Ivanhoe Mines, 39,6 % par le groupe chinois Zijin Mining, 20 % par l’État congolais, et 0,8 % par Crystal River Global Limited.
Louis-Nino Kansoun, Agence Ecofin
Lire aussi :
Kamoa-Kakula : l’objectif de 500 000 tonnes repoussé à 2027
Kamoa-Kakula : la demande électrique projetée à 347 MW d’ici fin 2028
Cuivre : la tonne frôle les 13 000 $ à Londres, sur fond d’inquiétudes
NIU Invest SE, actionnaire majoritaire de Critical Metals, a accordé à cette dernière un prêt de 2,1 millions de livres sterling, soit environ 2,84 millions de dollars américains, afin de financer notamment ses activités sur le projet cuprifère et cobaltifère de Molulu, situé à près de 100 kilomètres au nord de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Ce financement, annoncé par l’entreprise le 31 décembre 2025, est consenti sur une échéance de 18 mois, avec un taux d’intérêt de 10 % l’an, payable à la fin de la période.
Selon les termes communiqués, ce prêt prend la forme d’une obligation convertible, un mécanisme qui permet à NIU Invest SE de convertir, à tout moment et sous certaines conditions, le montant prêté en parts dans le capital de Critical Metals. C’est par ce même type de mécanisme que la société d’investissement a progressivement renforcé sa position au capital, portant sa participation à 69,62 % et s’imposant comme actionnaire de contrôle.
Ce financement apporte un nouveau souffle à Critical Metals, dont le projet de Molulu, détenu à 70 %, n’a pas encore généré de ventes commerciales. L’entreprise évolue toujours dans le rouge. Pour l’exercice financier clos le 30 juin 2025, elle a enregistré des pertes d’environ 2,4 millions de livres sterling, en baisse d’environ 13 % par rapport à l’exercice précédent, clos le 30 juin 2024, au cours duquel les pertes s’élevaient à près de 2,8 millions de livres.
D’après le rapport financier, cette amélioration relative s’explique principalement par une réduction d’environ 25 % des charges salariales, combinée à des coupes importantes dans les effectifs en République démocratique du Congo (RDC), notamment parmi les techniciens. Les mesures de réduction des coûts ont également concerné la direction, avec des baisses de rémunération du poste de directeur général allant jusqu’à 30 % depuis le 1er janvier 2025.
Premières ventes annoncées en 2026
Parallèlement à ces ajustements financiers, Critical Metals a connu plusieurs changements à sa tête. Après la démission de Russell Fryer le 4 septembre 2025, remplacé par Ali Farid Khwaja, ce dernier a à son tour quitté ses fonctions le 16 décembre 2025. Depuis cette date, Danilo Lange assure le rôle de directeur général par intérim.
Dans son annonce, l’entreprise présente Danilo Lange comme un dirigeant international expérimenté, fort de plus de 25 ans de carrière dans les secteurs minier, des biens de consommation et du marketing. Il a notamment occupé des postes de direction au sein de groupes tels que Yahoo et Red Bull, et a précédemment été directeur général de Auriant Mining AB, une société minière suédoise cotée sur la bourse américaine Nasdaq.
Selon Critical Metals, son profil est jugé adapté pour accompagner l’entreprise dans une phase de transition, alors que le conseil d’administration mène un processus de recherche pour un directeur général permanent.
Ce prêt accordé par NIU Invest traduit une nouvelle fois la confiance de l’actionnaire majoritaire dans le potentiel du projet de Molulu, malgré des résultats financiers négatifs enregistrés depuis le lancement. Il permet à l’entreprise de sécuriser le financement de ses activités à court terme, dans l’attente d’une montée en puissance opérationnelle.
Selon le rapport le plus récent de Critical Metals, les premières ventes de minerais issues de la mine de Molulu sont désormais envisagées à l’horizon de la mi-2026.
Timothée Manoke
Lire aussi :
Mine de cuivre-cobalt de Molulu : NIU contrôle désormais 70% de Critical Metals