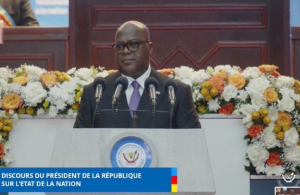Equipe Publication
Insertion professionnelle : 115 jeunes diplômés rejoignent Rawbank via RawTalents
Rawbank, première institution bancaire de la République démocratique du Congo (RDC), a clôturé le 1ᵉʳ décembre 2025 la 6ᵉ édition de RawTalents, son programme de recrutement et de renforcement des capacités destiné aux jeunes diplômés de moins de 27 ans. L’initiative cible des candidats titulaires d’un diplôme de licence ou de master obtenu au cours des trois dernières années, avec une moyenne minimale de 70 %, dans des filières telles que l’économie, le droit, le management, la communication, l’informatique ou les mathématiques.
Pour la promotion 2025, 115 jeunes ont achevé le cycle par la présentation de leurs projets, dernière étape de la formation conditionnant leur validation et leur intégration au sein de la banque. Cette cohorte marque une montée en puissance du programme, l’édition précédente, en 2024, n’ayant retenu que 25 participants.
« RawTalents promeut des jeunes fraîchement sortis de l’université. Ils sont formés au secteur bancaire pour leur donner les outils nécessaires à la construction d’une carrière solide », rappelle Zénas Momonzo, cadre de Rawbank.
Durant plusieurs mois, les participants ont bénéficié d’un apprentissage intensif couvrant la réglementation et la déontologie bancaires, les mécanismes de taux, les opérations de change, la gestion des produits financiers, ainsi que le traitement comptable des opérations et des investissements. Des modules sur la gestion opérationnelle des activités bancaires ont également été dispensés.
Lancé à l’origine sous l’appellation « Jeunes Universitaires », le programme a été rebaptisé RawTalents en 2024 afin de mieux refléter son ambition : identifier, former et accompagner les futurs acteurs du secteur bancaire congolais. Il inclut notamment un stage professionnel de six mois, préalable à l’intégration définitive des lauréats. Pour l’heure, le programme est opérationnel dans deux pôles du pays : Kinshasa (région Ouest) et le Haut-Katanga (Sud), où les jeunes sélectionnés bénéficient d’un cadre d’accompagnement structuré.
Ronsard Luabeya
Lire aussi :
À l’ONU, Rawbank met en avant son rôle dans l’atteinte des ODD en RDC
Basketball : Rawbank investit dans la promotion des talents congolais
En 2024, Rawbank conjugue croissance, transformation digitale et impact social
Cobalt : les exportations toujours bloquées en RDC, les nouvelles règles en cause
Malgré la publication, le 2 décembre 2025, de la note circulaire interministérielle Mines/Finances, les exportations de cobalt n’ont toujours pas repris en République démocratique du Congo (RDC). Ce texte, qui fixe les dispositions pratiques relatives à l’exportation du cobalt, était pourtant présenté comme le dernier acte administratif nécessaire à la reprise des expéditions, après la fin de près de huit mois d’embargo intervenue le 15 octobre.
En réalité, le système de quotas et les nouvelles formalités d’exportation préoccupent les exportateurs. C’est ce qui ressort d’une correspondance adressée le 4 décembre au ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, par la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo (FEC). Selon l’organisation patronale, ses membres rencontrent « de sérieuses difficultés dans l’application des quotas qui leur ont été attribués », et la note circulaire publiée le 2 décembre « ne répond pas aux préoccupations soulevées par les exportateurs de cobalt ».
Dans cette correspondance, la Chambre des mines pointe plusieurs zones d’ombre dans le dispositif de régulation adopté par l’Autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques (Arecoms).
Sujets d’inquiétudes
Premier point : le quota stratégique. Fixé à 9 600 tonnes pour 2026, en plus des quotas non consommés par les sociétés minières, il est présenté comme un instrument de souveraineté et de financement de projets nationaux. Mais ses modalités d’attribution ne sont pas connues.
Deuxième point : l’obligation de prépaiement de la redevance minière avant toute exportation. Cette mesure est jugée incompatible avec le Code minier, son règlement d’application et l’ordonnance-loi n° 13/003 encadrant les recettes non fiscales.
Troisième point : l’omission de certaines entreprises dans la liste des bénéficiaires de quotas, malgré leur présence dans des fichiers antérieurs. Les opérateurs signalent que les critères appliqués (seuil minimal de 100 tonnes, statut du gisement, antériorité de l’activité) ne prévoient aucun mécanisme de recours.
Quatrième point : l’incertitude sur la définition de la « quantité de cobalt métal » servant de base au calcul des quotas. Les minier soutiennent qu’aucune méthodologie officielle n’est fournie, ouvrant la voie à des divergences entre laboratoires et à des litiges potentiels.
Dernier point : les nouvelles formalités d’exportation. Elles incluent une attestation de vérification du quota (AVQ), des prélèvements supervisés par plusieurs services, un certificat Arecoms et des analyses croisées. Le nouveau dispositif place aussi le régulateur au centre de la chaîne d’exportation. Son intervention dans les inspections, analyses, contrôles documentaires et la délivrance d’autorisations crée, selon les opérateurs, un chevauchement de compétences avec les régies financières (DGDA, DGRAD) et les organismes techniques (CEEC, OCC). Ces étapes successives rallongent par ailleurs les délais et multiplient les risques de blocage.
Des concertations sollicitées
« Il est donc urgent de lever les ambiguïtés actuelles afin de garantir la sécurité juridique des opérateurs, d’assurer la fluidité des exportations et de préserver l’attractivité de notre secteur minier auprès des investisseurs », écrit la Chambre des mines dans le courrier signé par son président, Kassongo Bin Nassor, et l’administrateur délégué de la FEC, Thierry Ngoy Kasumba.
Pour y parvenir, l’organisation patronale — qui dit avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec les autorités de l’Arecoms sans succès — saisit donc le ministre Louis Watum en vue d’obtenir une séance de travail dans le Cadre de concertation entre les opérateurs miniers et le ministère, mécanisme mis en place en octobre dernier pour structurer le dialogue institutionnel.
La RDC reste le premier producteur mondial de cobalt, avec plus de 74 % des approvisionnements en 2024. Depuis l’embargo sur les exportations institué en février, le prix du métal a bondi d’environ 110 %, atteignant 52 220 dollars la tonne lundi soir à la Bourse des métaux de Londres.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Reprise des exportations de cobalt : la RDC débloque la dernière étape administrative
Cobalt : la RDC attribue les quotas, CMOC capte la plus grosse part mais…
DRC’s Mbuji-Mayi Hopes for Power Restoration as New Transformer Due Dec. 14
Power supplies in the city of Mbuji-Mayi could stabilise in the coming days after a blackout lasting more than three weeks. A new transformer is expected to arrive shortly to replace faulty equipment that caused major power outages.
The 300,000-dollar transformer has already been ordered and is due to arrive at the port of Matadi by Dec. 12, provincial governor Jean-Paul Mbwebwa Kapo said during a programme broadcast on Dec. 3 by state broadcaster RTNC. He said electricity would be restored as soon as possible.
Asked about the issue at the Makutano Forum on Nov. 26, SNEL director-general Teddy Lwamba reiterated that the new transformer would reach Mbuji-Mayi by Dec. 14.
Lwamba said the transformer failure cut the city off from the 3 MW supplied by the Tubi-Tubidi hydropower plant under a power purchase agreement between SNEL and mining company SACIM, which owns the facility. As a result, Mbuji-Mayi is currently running on an 800 kVA thermal plant, far below demand. He added that efforts are under way to raise capacity to 1,300 kVA.
The power shortage has severely disrupted drinking-water supply. To tackle these underlying problems, the head of the water utility REGIDESO, David Tshilumba Mutombo, announced plans to build a solar power plant.
“We have worked for the last three years with German cooperation to secure funding for a 15-megawatt solar plant,” Mutombo said. “The detailed design studies are complete. We hope to begin construction in January so Mbuji-Mayi can become energy independent and ensure continuous water service.”
Boaz Kabeya
Mbuji-Mayi : des solutions annoncées pour réduire les coupures d’électricité
La ville de Mbuji-Mayi, plongée dans le noir depuis plus de trois semaines, pourrait voir son alimentation électrique stabilisée dans les prochains jours. La livraison du nouveau transformateur, destiné à remplacer l’équipement défectueux à l’origine des graves perturbations dans la fourniture d’électricité, est annoncée pour les jours à venir.
« Ce transformateur, dont la valeur est estimée à 300 000 dollars, a déjà été commandé à l’étranger. Il devrait arriver à Matadi d’ici le 12 décembre 2025 », a indiqué le gouverneur du Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mbwebwa Kapo, lors d’une émission spéciale diffusée le 3 décembre sur la RTNC. Il a également assuré que le rétablissement de l’électricité interviendrait dans les meilleurs délais.
Interpellé sur la même question au Forum Makutano, le 26 novembre 2025, le directeur général de la Société nationale d’électricité (SNEL), Teddy Lwamba, avait fait la même annonce, précisant que le nouveau transformateur serait à Mbuji-Mayi le 14 décembre.
Teddy Lwamba a expliqué que, depuis l’avarie du transformateur, la ville ne reçoit plus les 3 MW fournis par la centrale hydroélectrique de Tubi-Tubidi, comme prévu dans le contrat d’achat d’électricité liant la SNEL à la société minière SACIM, propriétaire de la centrale. En conséquence, Mbuji-Mayi n’est, pour l’heure, alimentée que par une centrale thermique d’une capacité de 800 kVA, très insuffisante au regard des besoins de la ville. Il a ajouté que des mesures sont en cours pour porter cette capacité à 1 300 kVA.
Le déficit énergétique reste toutefois très important, perturbant notamment l’approvisionnement en eau potable. Pour remédier à ces contraintes structurelles, le directeur général de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO), David Tshilumba Mutombo, a annoncé la construction d’une centrale solaire. « Nous avons travaillé ces trois dernières années avec la coopération allemande pour sécuriser un financement pour une centrale solaire de 15 mégawatts. Nous avons terminé les études de conception détaillées. Nous espérons que, d’ici le mois de janvier, nous allons commencer la construction d’une centrale de 15 mégawatts à Mbuji-Mayi, pour nous rendre indépendants sur le plan énergétique et assurer un service de l’eau 24 heures sur 24 », a-t-il déclaré.
Boaz Kabeya
Lire aussi :
Mbuji-Mayi : le déficit d’électricité provoque une pénurie d’eau
Mbuji-Mayi : une centrale solaire de 15 MW pour stabiliser l’approvisionnement en eau
Centrale de Tshiala : l'Américain Anzana Electric veut investir 60 millions
Eau et électricité : vers une hausse des tarifs pour soutenir REGIDESO et SNEL
DRC: Félix Tshisekedi Says Economy Withstood Wartime Turmoil
- Inflation dropped from 11.7% to 2.5% and the franc appreciated 29% against the dollar.
- International reserves reached $7.4 billion, equal to three months of imports.
- The goods balance showed a $9.9 billion surplus in August 2025, driven by mining exports.
Amid a year defined by escalating conflict in eastern Congo, external shocks, and global geopolitical instability, President Félix Tshisekedi told Parliament on December 8 that the Congolese economy “held firm.” He defended what he described as unprecedented macroeconomic resilience in a hostile environment.
He supported this assertion with several indicators that showed stronger macroeconomic stability in 2025. Inflation provided the most notable signal of improvement. Tshisekedi said inflation fell from 11.7% at the end of 2024 to 2.5% at the end of October 2025, well below the 7% target set by the Central Bank of Congo.
This sharp disinflation coincided with a 29% appreciation of the Congolese franc against the dollar on both the interbank and parallel markets. The franc strengthened from 2,800 per dollar in August to 2,200. The country had not seen such an appreciation in years, especially given that exchange-rate pressure long served as the main driver of inflation.
At the same time, international reserves reached $7.4 billion, equivalent to three months of imports and aligned with IMF standards. These larger buffers provided a critical safety net as global commodity prices fluctuated.
Another key indicator strengthened as well: the balance of goods remained strongly positive, with a surplus of $9.9 billion as of August 2025. Mining exports continued to support external earnings and kept the surplus wide.
Economic growth reached an estimated 5.6% in 2025, above the sub-Saharan average of 3.8%–4.1%. Although the extractive sector remained the main engine, Tshisekedi argued that non-mining sectors also expanded in line with the government’s diversification agenda.
According to the president, these results flowed from the 2024–2028 Action Program, which focuses on household purchasing power, job creation, and competitiveness within a more diversified economy.
To strengthen the social impact of stabilization, the government launched measures to curb living costs. Tshisekedi said these measures produced concrete results. He noted that the pump price of gasoline in Kinshasa fell from 2,990 to 2,440 Congolese francs. In the maize sector in Greater Katanga, he said the price of a 25-kg bag dropped from $50 during the lean season to $13–15.
These developments, he argued, show that macroeconomic stability delivered tangible benefits as the country confronted war and volatility.
This article was initially published in French by Pierre Mukoko
Adapted in English by Ange Jason Quenum
Félix Tshisekedi : « Dans un contexte de guerre, notre économie a tenu »
Malgré une année marquée par la dégradation de la situation sécuritaire à l’Est, les chocs externes et les turbulences géopolitiques mondiales, l’économie de la RDC « a tenu ». C’est le message porté par le président Félix Tshisekedi, ce 8 décembre 2025, devant le Parlement, défendant l’idée d’une résilience macroéconomique inédite dans un environnement particulièrement hostile.
Pour étayer cette affirmation, plusieurs indicateurs témoignent en effet d’une amélioration sensible de la stabilité macroéconomique au cours de l’année 2025. L’un des signaux les plus marquants concerne l’inflation. Selon le chef de l’État, celle-ci serait passée de 11,7 % fin 2024 à 2,5 % fin octobre 2025, nettement en dessous de l’objectif de 7 % fixé par la Banque centrale du Congo (BCC).
Cette décélération spectaculaire s’accompagne d’une appréciation de 29 % du franc congolais (FC) face au dollar, aussi bien sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle. De 2800 francs au mois d’août, un dollars se change aujourd’hui à 2200 FC. Une telle appréciation du taux de change n’avait plus été observée depuis plusieurs années, dans un pays où les tensions sur le marché des changes constituent le principal moteur inflationniste.
Parallèlement, les réserves internationales ont atteint 7,4 milliards de dollars, l’équivalent de trois mois d’importations, en ligne avec les standards du Fonds monétaire international (FMI). Ces réserves renforcées constituent un filet de sécurité majeur dans un contexte de prix internationaux volatils.
Autre indicateur mis en avant : la balance des biens, qui resterait largement excédentaire avec un surplus de 9,9 milliards USD fin août 2025. Cette dynamique est principalement portée par le secteur minier, dont les exportations continuent de soutenir les recettes extérieures.
La croissance économique est estimée à 5,6 % en 2025, au-dessus de la moyenne de l’Afrique subsaharienne (entre 3,8 % et 4,1 %). Si le secteur extractif demeure le principal moteur de cette expansion, le chef de l’État affirme que les secteurs non miniers ont également gagné en dynamisme, conformément à l’objectif de diversification poursuivi par le gouvernement.
Ces performances, selon le président, s’inscrivent dans le cadre du Programme d’action 2024–2028, centré sur trois priorités : le pouvoir d’achat, l’emploi et la compétitivité d’une économie plus diversifiée.
Pour renforcer l’impact social de la stabilisation macroéconomique, le gouvernement a également mis en œuvre une politique de lutte contre la vie chère. Et selon Félix Tshisekedi, cette politique a porté ses fruits. Il cite notamment la baisse du prix de l’essence à la pompe, passée de 2 990 à 2 440 francs congolais à Kinshasa. Concernant la filière maïs dans le Grand Katanga, il indique que le sac de 25 kg est passé de 50 dollars pendant la période de soudure à 13–15 dollars.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Programme avec le FMI : la RDC en voie de recevoir plus de 450 millions $
Le FMI décaisse 262 millions $ pour renforcer le matelas de devises de la RDC
Budget 2025 : le FMI et la Banque mondiale atténuent l’impact de la crise à l’est de la RDC
BCC : la baisse des taux, un pari osé sur le franc congolais
Copper Seen Extending Rally Into 2026 After Hitting Record Levels
Citigroup analysts expect copper prices to rise above 13,000 dollars a ton by the second quarter of 2026, a forecast released last week as the metal continues to hit record highs on global markets. Copper reached 11,620 dollars on December 5 on the London Metal Exchange.
The three-month contract has gained about 30 percent since the start of the year, driven by tightening mine supply and expectations surrounding trade policy under the Trump administration. Citigroup says both factors could continue to support prices into 2026.
In anticipation of potential higher U.S. tariffs on refined copper, traders have been building inventories in U.S. warehouses. According to Bloomberg, about 60 percent of copper held in exchange-monitored storage is now located in the United States, largely at Comex facilities. The concentration of inventories could further tighten the market at a time when several major mines are facing significant disruption.
Weak Mine Supply
In the Democratic Republic of Congo, Ivanhoe Mines and its Chinese partners were forced to revise down production at the Kamoa-Kakula complex after a seismic incident in May 2025. The mine was originally expected to produce at least 500,000 tons in 2025 but now targets a maximum of 420,000 tons, a level also anticipated for 2026. Output is projected to recover to 540,000 tons in 2027.
In Indonesia, a landslide at Grasberg, the world’s second-largest copper mine, led Freeport-McMoRan to suspend part of its operations, prompting a 35 percent cut to its 2026 production outlook. Operational challenges at Chile’s Quebrada Blanca mine have also weighed on output forecasts.
By late November, J.P. Morgan estimated that global supply growth would remain weak this year and reach only about 1.4 percent in 2026, nearly 500,000 tons below its earlier projections.
“All in all, we think these unique dynamics of disjointed inventory and acute supply disruptions tightening the copper market add up to a bullish set up for copper, and are enough to push prices above $12,000/mt in the first half of 2026,” said Gregory Shearer, head of base and precious metals strategy at J.P. Morgan.
Debate Over Shortage Risks
However, new U.S. tariffs are not guaranteed, and any easing of trade tensions could relieve pressure on supply. Analysts at Benchmark Minerals have questioned the likelihood of an actual shortage, suggesting the market may be reacting to speculative signals.
Goldman Sachs does not expect a genuine market deficit before 2029 and forecasts that prices are unlikely to remain above 11,000 dollars a ton for long. BloombergNEF, meanwhile, estimates that the copper market fell into structural deficit as early as 2025, a gap it believes could widen to 19 million tons by 2050.
Emiliano Tossou
Kinshasa Roadworks Damaged $1.4m in Pipes, Cut Off 8,000, Says REGIDESO
The director-general of Regie de distribution d’eau (REGIDESO), David Tshilumba Mutombo, said the public utility sustained significant damage during Kinshasa’s road modernization projects. Speaking on Top Congo FM on December 1, he noted that REGIDESO recorded about 1.4 million dollars’ worth of damaged pipes and more than 8,000 customer disconnections. He also acknowledged a decline in the company’s performance in the second half of 2025.
In October, REGIDESO said it had already sent repair cost estimates to the contractors responsible for the roadworks. Tshilumba added that several cases have now been referred to the courts. “When we go to court, the results are better. Last week, we recovered a payment of 100,000 dollars,” he said.
Meanwhile, the Technical Control Office (BTC) reported in June that progress on certain road projects had been delayed because machinery was repeatedly striking underground installations belonging to the national electricity company SNEL and REGIDESO. “Whenever our equipment hits these installations, we either get cracks or full pipe bursts that cause major leaks. This slows us down because we have to wait for repairs before continuing,” said Emile Imela, BTC’s permanent controller, as quoted by the Congolese Press Agency (ACP).
To improve coordination across public works, the Postal and Telecommunications Regulatory Authority (ARPTC) published a manual of administrative and technical procedures in August. Developed with input from several public agencies, including the Congolese Agency for Major Works (ACGT), the Roads Office, the Road and Drainage Office (OVD), SNEL and REGIDESO, the document aims to standardize how public utility infrastructure is deployed and strengthen coordination among the institutions involved in urban projects.
Timothée Manoke
Cuivre : après une année record, les prix annoncés à la hausse en 2026
Les analystes du groupe financier américain Citigroup prévoient un prix du cuivre supérieur à 13 000 dollars la tonne d’ici le deuxième trimestre 2026. Cette projection, annoncée la semaine dernière, intervient alors que le cours du métal rouge bat des records sur les marchés internationaux, atteignant 11 620 dollars le 5 décembre à la Bourse des métaux de Londres.
Le contrat pour livraison dans trois mois a progressé d’environ 30 % depuis le début de l’année, atteignant des niveaux historiques. Cette hausse est alimentée par des tensions sur l’offre minière, mais aussi par des anticipations liées aux orientations commerciales de l’administration Trump. Selon Citigroup, ces facteurs devraient continuer de soutenir les prix en 2026.
Dans la perspective de droits de douane plus élevés aux États-Unis sur le cuivre raffiné, les négociants accumulent des stocks dans les entrepôts américains. D’après Bloomberg, 60 % des stocks de cuivre détenus dans les entrepôts contrôlés par les bourses mondiales sont désormais concentrés aux États-Unis, principalement dans ceux du Comex. Cette situation pourrait contribuer à tendre davantage le marché, alors même que plusieurs grandes mines connaissent d’importantes perturbations.
Faible croissance de la production minière
En RDC, où Ivanhoe Mines et ses partenaires chinois exploitent l’une des plus grandes mines de cuivre au monde (Kamoa-Kakula), l’incident sismique de mai 2025 a affecté les prévisions de production. Alors que l’entreprise visait initialement au moins 500 000 tonnes de cuivre en 2025, elle n’en attend plus que 420 000 tonnes au maximum, un niveau également anticipé pour 2026. Une remontée à 540 000 tonnes est envisagée en 2027.
En Indonésie, un glissement de terrain survenu à Grasberg — deuxième plus grande mine mondiale — a contraint Freeport McMoRan à suspendre une partie des opérations, entraînant une réduction de 35 % de la production prévue en 2026. Au Chili, des difficultés opérationnelles à la mine de Quebrada Blanca ont également pesé sur les projections.
Fin novembre, J.P. Morgan a ainsi estimé que la croissance de l’offre mondiale resterait faible en 2025, avant de n’atteindre qu’environ 1,4 % en 2026, soit près de 500 000 tonnes de moins que ses prévisions initiales.
« Dans l'ensemble, nous pensons que ces dynamiques uniques, mêlant inventaires disloqués et perturbations aiguës de l’offre minière, installent un cadre résolument haussier pour le cuivre et suffisent à propulser les prix au-delà de 12 000 dollars la tonne au premier semestre 2026 », analyse Gregory Shearer, responsable de la stratégie métaux de base et métaux précieux chez J.P. Morgan.
Risques de pénurie contestés
L’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains n’est toutefois pas garantie. Un apaisement des tensions pourrait relâcher les pressions sur l’approvisionnement. Certains analystes, dont ceux de Benchmark Minerals, s’interrogent sur la réalité des risques de pénurie, jugeant qu’ils pourraient relever davantage de la spéculation.
Pour Goldman Sachs, une véritable pénurie n’est pas attendue avant 2029, et les prix ne devraient pas rester durablement au-dessus de 11 000 dollars la tonne. De son côté, BloombergNEF estime que le marché mondial du cuivre entre dès 2025 dans un déficit structurel, susceptible d’atteindre 19 millions de tonnes d’ici 2050.
Emiliano Tossou, Agence Ecofin
Lire aussi :
Ventes des minerais critiques : vers une coentreprise Gécamines-Mercuria-DFC
Kamoa-Kakula : l’objectif de 500 000 tonnes repoussé à 2027
Kamoa-Kakula : vers un maintien des revenus à 3 milliards $ malgré l’incident sismique
Cuivre : Mercuria renforce ses approvisionnements depuis la RDC grâce à un accord avec ERG
Cuivre : CMOC veut porter ses capacités de production en RDC à plus 700 000 tonnes
Cuivre : des aléas en RDC et en Indonésie mettent l’offre mondiale sous pression
Travaux routiers à Kinshasa : 1,4 million $ de dégâts et 8 000 abonnés privés d’eau
Le directeur général de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO), David Tshilumba Mutombo, a déploré, lors d’une émission sur Top Congo FM le 1ᵉʳ décembre 2025, les dommages subis par l’entreprise publique dans le cadre des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa. Selon lui, des tuyaux cassés pour une valeur estimée à 1,4 million de dollars ont été enregistrés et plus de 8 000 clients déconnectés, au moment où il reconnaissait un recul des performances de la société au deuxième semestre 2025.
En octobre, la REGIDESO affirmait avoir déjà transmis des devis de réparation aux entreprises chargées des travaux. Le directeur général a indiqué que certains dossiers sont désormais entre les mains de la justice. Il a évoqué les premiers résultats obtenus dans ce cadre, assurant que les actions judiciaires se révèlent efficaces. « Je veux vous dire que quand nous allons à la justice, les résultats sont meilleurs. La semaine dernière, nous avons reçu un paiement de quelqu’un pour 100 000 dollars », a-t-il déclaré.
De son côté, le Bureau technique de contrôle (BTC) relevait en juin dernier des retards dans l’exécution des travaux de voirie en raison des installations souterraines de la Société nationale d’électricité (SNEL) et de la REGIDESO. « À chaque contact avec nos engins, c’est soit une fissure ou complètement l’éclatement d’un tuyau, provoquant ainsi une forte fuite d’eau. Cela nous ralentit, car il faut attendre les réparations pour continuer », expliquait alors Emile Imela, contrôleur permanent au BTC, cité par l’Agence congolaise de presse (ACP).
Face à ces problèmes de coordination entre acteurs publics, un manuel de procédures administratives et techniques a été publié en août par l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo (ARPTC). Élaboré avec la participation de plusieurs institutions — l’Agence congolaise des grands travaux (ACGT), l’Office des routes, l’Office des voiries et drainage (OVD), la SNEL et la REGIDESO —, ce document vise à encadrer le déploiement des infrastructures d’utilité publique et à améliorer la coordination entre les structures impliquées dans les travaux urbains.
Timothée Manoke
Lire aussi :
Eau et électricité : vers une hausse des tarifs pour soutenir REGIDESO et SNEL