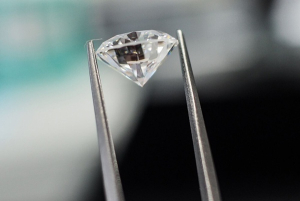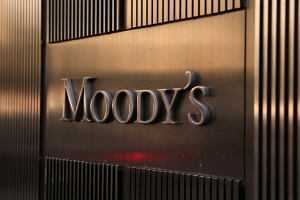Equipe Publication
Equity mise sur la RDC pour sa croissance, malgré les contraintes réglementaires
Dans un document présentant ses performances de l’année 2024 aux investisseurs, Equity Group Holdings (EGH) décrit la République démocratique du Congo (RDC) comme « une nouvelle frontière prometteuse pour une croissance durable continue » du groupe. En d’autres termes, EGH voit la RDC comme un pays à fort potentiel où sa filiale Equity BCDC peut se développer durablement dans les années à venir, malgré les défis actuels.
Selon Innogence Consulting, cabinet de conseil en stratégie et en management, qui accompagne plusieurs banques congolaises, le marché bancaire devrait enregistrer une forte croissance en RDC dans les prochaines années. En s’appuyant sur le taux de croissance moyen annuel de la dernière décennie, Landry Djimpe, associé chez Innogence Consulting et responsable du bureau RDC, projette dans un article publié en janvier dernier une multiplication par trois du total bilan des banques, passant de 18,1 milliards de dollars en 2023 à 60 milliards en 2030.
Le pari d’EGH s’appuie sur plusieurs éléments : la richesse du pays en minerais stratégiques, le potentiel agricole avec environ 80 millions d’hectares de terres arables, un gisement hydroélectrique estimé à plus de 64 000 MW, un dividende démographique favorable avec une population jeune, une position géographique stratégique et des réformes institutionnelles et de gouvernance qualifiées de « solides » qui ont renforcé la coopération avec la Banque mondiale et le FMI.
À ces atouts, Landry Djimpe ajoute la transformation numérique. Il estime que jusqu’à 50 millions de personnes pourraient utiliser des services financiers numériques en RDC à l’horizon 2030. Selon lui, la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’inclusion financière (SNIF 2023-2028), qui ambitionne de faire passer le taux d’inclusion de 36,5 % à 65 %, et les investissements publics en cours devraient également favoriser une bancarisation plus large.
Plus forte part de marché
Dans un contexte de tensions commerciales internationales et de révision des priorités des grandes économies, la RDC semble relativement préservée. Ses principales exportations — les minerais liés à la transition énergétique — ne sont pas affectées par les droits de douane américains. Même si la demande chinoise, principal partenaire actuel, peut ralentir, les États-Unis, engagés dans un effort de réindustrialisation, pourraient devenir un nouveau moteur pour les prix des matières premières.
Par ailleurs, les perturbations sécuritaires à l’est de la RDC, dues aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, semblent évoluer vers une résolution pacifique, ouvrant la voie à des investissements américains.
Equity peut également compter sur ses propres forces. Présent au Kenya, en RDC, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et au Soudan du Sud, le groupe bancaire est au cœur de la dynamique commerciale de l’Afrique de l’Est. Il bénéficie notamment de la hausse des échanges commerciaux entre la RDC et les pays voisins. Actuellement, la RDC est le 4 ᵉ partenaire commercial du Kenya, siège d’EGH. À fin septembre 2024, les échanges entre les deux pays ont progressé de 23 %, un chiffre inférieur aux 43,4 % enregistrés en 2023 sur la même période, mais qui demeure la meilleure performance parmi les marchés où le groupe opère.
Aujourd’hui, la RDC est le pays où Equity détient sa plus forte part de marché. En RDC Equity contrôle 27 % du marché bancaire, contre 17,7 % au Rwanda, 15,1 % au Sud-Soudan, 13,1 % au Kenya, 7,4 % en Ouganda et 1,7 % en Tanzanie. Par ailleurs, depuis 2020, la clientèle d’Equity BCDC a plus que doublé, passant de 0,89 à 1,86 million de clients à fin octobre 2024, selon les données publiées par l’entreprise.
Toutefois, les contraintes réglementaires devraient mitiger la contribution de la RDC aux performances financières d’Equity Group Holdings. Une directive de la Banque centrale du Congo impose, à compter de juillet 2026, une limite de 55 % à la part que peut détenir un actionnaire dans le capital d’une banque.
Cette mesure, adoptée après le rachat d’Equity BCDC par EGH, risque de peser sur les revenus futurs et de remettre en question le modèle économique initial du groupe dans le pays. Avec 85 % des parts, Equity Group affirme rencontrer des difficultés à identifier des repreneurs crédibles pour céder les 35 % nécessaires à sa mise en conformité avec la directive du régulateur.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Les banques de RDC sous pression pour attirer de nouveaux actionnaires d’ici juillet 2026
Promotion des exportations : un programme de financement en préparation avec Equity BCDC
Kasaï Central : Equity BCDC se positionne pour élargir son portefeuille clients
EquityBCDC : Willy Mulamba face au défi des créances à risque
Spurred by Recent Floods, DRC Authorities to Demolish Buildings in Kinshasa
At the 41st meeting of the Council of Ministers, held on April 25, 2025, President Félix Tshisekedi ordered the demolition of buildings erected in violation of town-planning standards, especially those obstructing drainage channels. This decision comes after floods hit Kinshasa, causing almost 75 deaths and leaving more than 11,000 people homeless, according to the authorities.
The government has set up a crisis unit, bringing together several ministers and the governor of Kinshasa, to ensure that this decision is rigorously enforced. The process includes an awareness-raising phase, followed by formal notices to the offenders, before proceeding with demolitions. The awareness campaign aims to curb social tensions.
On April 10, 2025, Crispin Mbadu, Minister of Urban Planning and Housing, called a meeting of his administration to assess the consequences of the recent floods. He called for the strict application of the ban on issuing town-planning notices in certain non-edificandi zones, notably Ngaliema Bay, the banks of the Ndjili, Lukunga, Kalamu, Bitshaku Tshaku, Basoko, Makelele, and Gombe rivers, as well as the Socopao site in Limete and the Ndanu district.
As part of the Kin-Elenda project, the authorities had already launched demolition operations in November 2024 on houses built illegally along the Funa river, in the communes of Kalamu, Barumbu, and Limete. This work aimed to protect the SNEL substation from flooding and restore the free flow of water.
Boaz Kabeya (intern)
DRC: Power Utility Appoints Chinese Firm to Rehabilitate Supply Network in Northen Kinshasa Area
On April 24, 2025, the SNEL, the DR Congo’s power utility, signed a contract with Chint, a Chinese firm, to rehabilitate the electricity distribution network in northern Kinshasa, covering five communes: Barumbu, Gombe, Kasa-Vubu, Kinshasa, and Lingwala.
Initially, the project aimed to build 60 new low- and medium-voltage cabins, modernize 35 existing cabins, and reinforce a substation and a high-voltage substation. However, the project scope has expanded: 204 cabins will now be renovated, 25,000 subscribers will switch to prepaid billing, and 1,175 street lamps will be installed to improve public lighting.
SNEL Managing Director Fabrice Lusinde said the project, a pilot, will be extended to other communes amid rapid urbanization and growing energy demand. The current network, largely inherited from colonial times, has not been rehabilitated for over 60 years, causing significant energy losses and outdated flat-rate billing.
Founded in 1984, Chint Electric is a subsidiary of the Chinese conglomerate CHINT Group, specializing in electrical equipment, renewable energy, and intelligent energy management solutions. Present in over 140 countries, the company has carried out several electrification projects in Africa, including Ethiopia, Ghana, and Nigeria.
This article was initially published in French by Boaz Kabeya (intern)
Edited in English by Ola Schad Akinocho
Diamond Market Faces Major Crisis Amid Falling Demand and Prices
The diamond market is going through a major crisis, marked by a prolonged drop in demand, due in particular to the growing popularity of synthetic diamonds. This has led to a significant fall in prices. Several corroborating sources say prices have fallen by over 25% since 2022.
The trend is reflected in the average export price from the Democratic Republic of Congo (DRC). According to official data, it has fallen from $12.5 per carat in 2022 to $9.6 in 2024, a drop of 23.2%.
This situation further complicates the recovery of Société minière de Bakwanga (Miba), which has been in difficulty for over twenty years. The turnaround strategy is based on the potential of the polygon, Miba's historic concession, which still harbors significant diamond deposits.
On April 8, Miba CEO André Kabanda introduced four South African companies- Bond Equipment, Mining Services, Athur Mining, and Consulmet-"interested" in working together to revive the business. These companies are due to submit bids for the supply of modern equipment after visiting the mining infrastructure and sites. However, the continuing fall in prices could dampen investor enthusiasm.
Conditions for a Relaunch
Appointed Chairman of the Board in November 2023, Jean-Charles Okoto undertook a tour of Europe in late 2024 to attract new partners. On this occasion, ASA Resource, a 20% shareholder, pledged to invest $50 million in the relaunch. To date, however, it remains unclear whether this contribution has been made.
While Miba's ambition was to produce 12 million carats by 2025, its activities remain suspended.
Miba's situation reflects that of the sector as a whole. Since 2017, recorded national production has fallen from 17.9 million to 9.2 million carats in 2024.
"Relaunching the sector requires structural reforms to enhance transparency, support artisanal mining, attract industrial investment, and ensure that diamond wealth truly benefits local populations," argues IPIS, a research organization based in Antwerp, in a report published on April 23, 2025.
According to the USGS, the DRC holds around 150 million carats, or 9% of the world's known industrial-grade diamond reserves.
This article was initially published in French by Pierre Mukoko
Edited in English by Ola Schad Akinocho
Emballages de ciment et minerais : le coup de pouce de l’État à Bags and Sacs
Selon un communiqué publié le 28 avril 2025, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a pris un arrêté interdisant, pour une durée de 12 mois, l’importation de sacs et d’emballages de ciment, ainsi que de sacs destinés aux minerais (big bags) dans la région sud-est de la République démocratique du Congo (RDC).
Les raisons de cette décision ne sont pas communiquées. Mais il va sans dire que cette mesure devrait profiter à l’industrie locale, dominée par Bags and Sacs (B&S). Premier fabricant de sacs en polypropylène tissé en RDC, l’entreprise dirigée par Hussein Ladha dispose de deux usines dans le pays, l’une à Kimpese (Kongo Central) et l’autre à Lubumbashi (Haut-Katanga).
La première est dotée d’une capacité de production annuelle de 40 millions de sacs de ciment et la seconde d’une capacité de 2 millions de big bags, soit 70 % de la demande nationale, selon l’entreprise, ainsi que 36 millions de sacs pour le ciment et les produits agricoles.
Malgré cette offre, B&S est butée à « la résistance des entreprises minières qui trouvent intérêt à continuer à importer les big bags », a avoué Hussein Ladha lors de la DRC Mining Week 2024, tenue en juillet dernier. La décision du ministre du Commerce extérieur apparaît donc comme une réponse à cette difficulté. Il faut dire que le gouvernement a soutenu l’implantation de cette entreprise avec un prêt du Fonds de promotion de l’industrie (FPI) dépassant les 12 millions de dollars.
Selon le communiqué, en cas de difficultés d’approvisionnement en produits locaux dans certaines parties du territoire national, les opérateurs économiques auront la possibilité d’obtenir, sans frais, une dérogation d’importation. Cette autorisation exceptionnelle devra être sollicitée auprès du ministre du Commerce extérieur, à travers une demande précise indiquant la destination et les détails de la marchandise concernée. La demande devra également être appuyée par un dossier complet validé par le Guichet unique intégral du commerce extérieur (SEGUCE-RDC), sous peine de rejet.
Ronsard Luabeya
DRC and Rwanda Sign “Declaration of Principles” with One-Week Peace Deadline
On April 25, 2025, the Democratic Republic of Congo (DRC) and Rwanda signed, in Washington, the "declaration of principles" to draw up a draft peace agreement for discussion on May 2.
The text lays down classic foundations: respect for sovereignty, non-interference, an end to support for armed groups, joint security coordination, return of refugees, support for MONUSCO, and promotion of regional economic integration. But an analysis of the speeches delivered at the signing reveals different priorities for different players.
DRC Puts Peace First
Congolese Foreign Minister Thérèse Kayikwamba Wagner, stressed the urgency of the move, saying: "In Goma, Bukavu and beyond, the reality is one of displacement, insecurity and hardship. For us, the urgency of this initiative is not theoretical, it is human."
She also demanded the "immediate, unconditional and verifiable" withdrawal of foreign troops, asserting that, "Peace must come first, then we can build trust, and only then engage in bilateral cooperation."
Rwanda Wants to Address Root Causes
Rwanda's Minister of Foreign Affairs, Olivier Nduhungirehe, for his part, insisted on the need to tackle the roots of the conflict: "We must address the root causes to achieve lasting peace," he insisted.
Kigali ties these causes to the "complex history" of the region. Rwanda continues to justify the M23's action by the defense of "Rwandophone populations" in Kivu and considers the Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), refugees in eastern DRC since the 1994 Rwandan genocide, as an "existential threat". The country's stated aim is to achieve "a secure region, free from violent ethnic extremism, and well governed."
US Targets Favorable Ecosystem
The United States, officially a "witness" to the process, is aiming beyond mediation. Secretary of State Marco Rubio said, "A lasting peace in the eastern Democratic Republic of Congo will open the door to greater US and Western citizen investment, which will create an ecosystem conducive to responsible and reliable supply chains for things like critical minerals. It's a win-win."
"We are discussing how to build new regional economic value chains linking our countries, including with US private sector investment," confirmed the Rwandan Minister of Foreign Affairs. Washington is currently negotiating a bilateral agreement with Kinshasa to secure access to strategic minerals.
Absent but Influential Players
Beyond the signatories, other players and interests are weighing in on the process. The United States accuses Chinese companies of taking advantage of the chaos to exploit resources illegally.
The governor of South Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, recently spoke of the existence of 1,600 illegal companies, mainly Chinese-owned, feeding a vast smuggling network that also benefits Rwanda. According to his estimates, 67% of this illegal production is destined for the Middle East, while China accounts for another significant share. Europe would remain marginal in these flows.
Countries such as Burundi and Uganda, as well as South Africa, which has already lost several soldiers, will also have to take their military interests into account. Finally, internal political tensions in the DRC further complicate the equation.
Authorities accuse former president Joseph Kabila of supporting the rebellion, adding a domestic political dimension to an already complex crisis.
This article was initially published in French by Georges Auréole Bamba
Edited in English by Ola Schad Akinocho
Secteur minier : la Belgique ouverte aux opportunités d’investissement en RDC
En visite en République démocratique du Congo (RDC), le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot (photo), a affirmé que son pays disposait d’entreprises capables d’apporter leur expertise dans le secteur minier de son ancienne colonie.
« Nous avons une expertise reconnue mondialement à travers des acteurs comme Umicore et John Cockerill, qui ont la capacité de traiter l’ensemble de ces matériaux critiques rares. Et donc, si l’opportunité se fait jour de pouvoir aussi être un partenaire d’investissement, il n’y a pas de raison que nous l’évacuons », a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse le 28 avril 2025, après des rencontres avec la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Umicore met déjà son expertise au service de la Gécamine. En 2024, l’entreprise minière publique a signé un accord avec la société belge, spécialisée notamment dans le recyclage de métaux, pour raffiner les concentrés de germanium issus du site de résidus miniers dénommé Big Hill à Lubumbashi. La Gécamine a annoncé en octobre 2024 les premières exportations vers la Belgique, dans le cadre de son objectif de fournir jusqu’à 30 % de l’approvisionnement mondial en germanium.
Le Royaume de Belgique est aussi une destination privilégiée pour les diamants congolais, notamment grâce à la ville d’Anvers, un centre mondial du commerce du diamant. En 2024, les statistiques publiées par le ministère des Mines montrent que la RDC a exporté 4,1 millions de carats vers la Belgique, pour une valeur de 42,03 millions de dollars. Le royaume représente ainsi 44 % des exportations congolaises de diamants, devancé seulement par les Émirats arabes unis, qui ont importé 4,9 millions de carats pour 44,9 millions de dollars.
Face à la domination chinoise, la RDC souhaite attirer de nouveaux acteurs dans le secteur minier. Des discussions sont déjà en cours avec les États-Unis, à la suite d’une proposition d’échange « minerais contre sécurité » faite par Kinshasa. Depuis lors, Washington est fortement impliqué dans la résolution du conflit à l’est de la RDC.
« La Belgique n’a à aucun moment conçu sa mission, à travers ma présence, dans une démarche visant à vampiriser quelconque ressource de la RDC. Nous sommes évidemment en observation par rapport aux motivations d’autres acteurs internationaux qui peuvent parfois avoir une approche plus transactionnelle de leur diplomatie. Nous sommes ici d’abord et avant tout parce qu’il y a une population qui souffre et des principes de droit international à faire respecter », a commenté Maxime Prévot.
Au sein de l’Union européenne, Bruxelles apparaît aujourd’hui comme le principal allié de Kinshasa dans le cadre du conflit à l’est de la RDC. En représailles, le Rwanda a suspendu ses relations diplomatiques avec le royaume.
Pierre Mukoko
Lire aussi :
Conflit à l’est de la RDC : une semaine pour concilier de multiples intérêts
Lithium de Manono : terrain favorable à Jeff Bezos et Bill Gates
Minerais de conflit : la RDC attaque Apple au pénal en France et en Belgique
Moody’s maintient la note souveraine de la RDC, malgré le conflit à l’est
Le 29 avril 2025, Moody’s Ratings a maintenu la note B3 de la République démocratique du Congo (RDC), avec une perspective stable, soulignant les forces économiques du pays malgré le conflit persistant dans ses provinces de l’est. Le rapport met en avant des perspectives de croissance positives, bien que moins vigoureuses qu’en 2023, ainsi que des réformes fiscales appuyées par le Fonds monétaire international (FMI), tout en alertant sur les risques liés à la dépendance aux matières premières et à l’instabilité régionale.
Selon les analystes de l’agence américaine de notation, l’économie de la RDC devrait croître de 6 % par an entre 2025 et 2027, soutenue par un secteur minier caractérisé par des coûts d’exploitation faibles. Les gisements de cuivre à haute teneur et la main-d’œuvre bon marché favorisent cette croissance, la production devant atteindre 3,5 millions de tonnes en 2026, contre 3,1 millions en 2024.
La discipline budgétaire et les réformes soutenues par le FMI renforcent les finances publiques congolaises. Une nouvelle Facilité élargie de crédit de 1,7 milliard de dollars et une Facilité pour la résilience et la durabilité de 1 milliard de dollars visent à améliorer la transparence et à augmenter les recettes publiques.
Celles-ci sont passées à 14,8 % du PIB grâce aux récents programmes du FMI, contre 12 % en moyenne entre 2015 et 2020. Des mesures telles que la facturation standardisée de la TVA et la mise en place d’un compte unique du Trésor sont en cours de mise en œuvre.
Des risques toujours présents
La dette publique, représentant 17,7 % du PIB en 2024, reste modérée et offre une certaine marge de manœuvre budgétaire. Les réserves de change ont atteint un niveau record de 6,1 milliards de dollars fin 2024, couvrant ainsi trois mois d’importations.
Cependant, selon Moody’s, plusieurs risques nécessitent une vigilance particulière de la part des acteurs économiques, notamment des investisseurs ciblant les titres d’emprunt. La dépendance aux exportations de minerais critiques expose la RDC à la volatilité des prix, particulièrement en cas de ralentissement de la demande chinoise, lié à des tensions commerciales mondiales.
Par ailleurs, le conflit dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, alimenté par le groupe rebelle M23 et les rivalités régionales, pèse sur les finances publiques et constitue un risque pour les investisseurs. « Une escalade pourrait perturber les opérations minières », avertit Moody’s. L’agence souligne néanmoins que les développements de ces derniers jours laissent entrevoir une possible désescalade à l’est, même si le M23 continue de contrôler une partie significative du territoire, selon les rapports des Nations unies.
Moody’s observe aussi que la faiblesse institutionnelle, la corruption et l’insuffisance des infrastructures limitent la capacité du pays à absorber ces chocs économiques.
Bonne nouvelle
Si cette notation ne bénéficie pas directement à l’État — qui n’est pas un émetteur majeur de titres d’emprunt sur les marchés internationaux des capitaux — elle représente néanmoins un avantage certain pour les entreprises, notamment celles du secteur minier, souvent actives sur ces marchés.
C’est notamment le cas d’Ivanhoe Mines, qui a levé jusqu’à 750 millions de dollars sur les marchés internationaux, ou de groupes comme Rawbank, la plus grande banque du pays, qui a indiqué en juin 2024 disposer de ressources issues de prêteurs internationaux, même s’il s’agit principalement d’institutionnels engagés dans le financement du développement.
La notation pourrait également modérer les attentes de retour sur investissement des partenaires étrangers, notamment américains, qui suivent de près les négociations en cours pour restaurer la stabilité dans l’est du pays. En général, une mauvaise note reflète un environnement d’affaires complexe et implique une exigence accrue de rendement pour l’engagement de capitaux, y compris dans les investissements de portefeuille.
Georges Auréoles Bamba
Lire aussi :
Est de la RDC : pour Moodys, le risque d’un conflit de grande envergure reste faible
Croissance, inflation : Moodys optimiste sur la RDC pour la période 2025-2028
Nord-Kivu : réhabilitation du pont Semuliki, trait d’union avec l’Ouganda et le Kenya
Selon une annonce du gouvernement provincial du Nord-Kivu, les travaux de réhabilitation du pont Semuliki débutent ce 29 avril 2025. Comme il s’agit d’un pont Acrow (pont modulaire préfabriqué en acier), les travaux consisteront à démonter l’ancien pont et à en installer un nouveau. Ils seront réalisés par l’Office des routes, avec l’appui de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).
Selon Nana Ombeni Kambale, chargé de la supervision technique du projet au sein de la MONUSCO, la mission onusienne va d’ailleurs offrir le pont complet, contenu dans 12 conteneurs. La MONUSCO a remis un premier lot de matériel à l’Office des routes.
Le pont Semuliki relie la ville de Beni, provisoirement devenue capitale régionale du Nord-Kivu après la prise de Goma par le M23, à la route nationale numéro 4 (RN4). Il s’agit d’un axe vital qui mène directement à Kasindi, principale porte d’entrée en Ouganda. De là, les marchandises poursuivent leur trajet vers Kampala, avant d’atteindre les ports de Mombasa ou Nairobi au Kenya. Et vice-versa.
Face à la dégradation de l’ouvrage, l’accès y a été restreint depuis le 14 avril 2025 pour éviter son effondrement. À l’issue d’une réunion entre le gouverneur militaire, la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la Direction générale des douanes et accises (DGDA), l’Office des routes et la MONUSCO, les véhicules d’une charge supérieure à 20 tonnes ont été interdits de traverser le pont.
Cette situation perturbe davantage les échanges commerciaux entre la province et les pays voisins, provoquant une hausse des prix de certaines marchandises et suscitant les inquiétudes des acteurs économiques de la sous-région.
Les autorités provinciales ont néanmoins mis en place des mesures visant à stabiliser les prix des produits de première nécessité durant la période de réhabilitation, qui n’a pas été précisée. Ainsi, un prix unique du carburant a été fixé à 3 900 FC le litre dans les villes de Beni et Butembo. Par ailleurs, la Direction générale des douanes et accises (DGDA) a reçu des instructions pour accorder la priorité au dédouanement des denrées alimentaires, des produits pétroliers et des médicaments.
Après s’être effondré sous le poids d’un camion en 2017, le pont Semuliki avait déjà été réhabilité avec l’aide de la MONUSCO.
Ronsard Luabeya
Lire aussi :
Commerce transfrontalier : des trajets plus longs entre Goma, Bukavu et l’Ouganda
Déclaration des biens des agents publics en RDC : lancement prévu pour décembre 2025
L’engagement de la République démocratique du Congo à lutter contre la corruption dans l’administration publique pourrait franchir une nouvelle étape dans six mois avec l’entrée en vigueur du décret portant régime de déclaration du patrimoine de l’agent public et des membres de sa famille immédiate. Ce délai doit permettre d’adopter le manuel de procédures et les directives d’application du décret.
Selon ce texte, signé le 9 avril 2025 par la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, dès décembre 2025, tout agent de l’État (du président de la République au simple agent) devra soumettre « des informations exactes et complètes sur son patrimoine et ses intérêts personnels, ainsi que ceux des membres de sa famille immédiate » auprès de l’Observatoire de surveillance de la corruption et de l’éthique professionnelle (OSCEP). Il devra s’acquitter de cette obligation à son entrée en fonction ou en début de mandat, durant l’exercice, et en fin de fonction ou de mandat.
Le décret précise que les agents publics déjà en fonction disposeront de 90 jours, à compter de l’entrée en vigueur du texte, pour procéder à leur première déclaration.
La déclaration concerne tous les avoirs, revenus, engagements financiers, ainsi que les transactions ou dépenses. Elle devra être effectuée sur un formulaire dénommé « Acte de déclaration de patrimoine et intérêt », par voie électronique, via une plateforme en ligne gérée par l’OSCEP. L’établissement public dispose de 12 mois (jusqu’en avril 2026) pour rendre cette plateforme opérationnelle. « Jusqu’au lancement effectif de la plateforme électronique, l’OSCEP désigne une méthode transitoire de soumission (…) en version papier… », précise le décret.
Sortir de la liste grise du GAFI
Tout agent qui se soustrait à cette obligation s’exposera à la fois à des « sanctions disciplinaires » et aux « peines prévues par le Code pénal ».
Pour les personnes politiquement exposées, la déclaration, conformément aux dispositions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sera accessible au public, à l’exception des sommes d’argent détenues dans des comptes bancaires en RDC ou à l’étranger. Mais, tous les biens des agents politiquement exposés ne seront pas accessibles au public : la liste des exemptions sera définie ultérieurement.
L’OSCEP doit aussi clarifier plusieurs points. Il s’agit notamment de la détermination des seuils applicables à certains revenus ou dépenses à déclarer.
Pour le ministère des Finances, cette réforme vise notamment à permettre à la RDC de sortir de la « liste grise » du Groupe d’action financière international (GAFI). Elle doit également rendre le pays éligible au programme américain Millennium Challenge Corporation (MCC), qui, au cours des 20 dernières années, a joué un rôle de catalyseur pour le financement des infrastructures en Afrique. Toutefois, les activités de ce programme ont été récemment suspendues par l’administration du nouveau président américain, Donald Trump, dans un souci d’efficience budgétaire.
Des réformes encore nécessaires
Si ce décret marque un pas décisif vers la mise en œuvre d’un cadre de transparence avancé en matière de propriété effective, plusieurs points méritent encore une attention particulière. L’accès aux informations sur le patrimoine des agents publics est jugé pertinent, notamment pour un pays riche en ressources minières critiques pour la transition énergétique.
Cependant, la chaîne de valeur des flux financiers criminels implique également des personnes qui ne sont pas des agents publics. Des efforts récents ont été menés pour garantir la disponibilité des informations sur la propriété effective, mais l’examen de 2023 du GAFI a relevé plusieurs aspects à améliorer.
Au-delà de la volonté de restaurer la moralité publique dans un pays où la corruption est régulièrement dénoncée comme un fléau — y compris par les autorités elles-mêmes —, cette mesure de transparence vise aussi d’autres objectifs : faciliter les transactions bancaires entre la RDC et l’étranger et attirer des investisseurs soumis à des normes strictes d’éthique et de moralité dans leurs propres pays, comme c’est notamment le cas pour certaines entreprises américaines.
Georges Auréole Bamba
Lire aussi :
Lutte contre les crimes économiques en RDC : un tribunal spécialisé en vue
Blanchiment d’argent : la RDC promet aux États-Unis une sortie de la « liste grise » en 2025