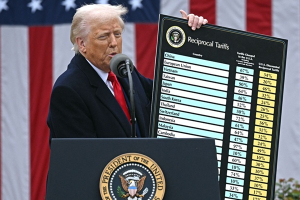Equipe Publication
Lithium: Kobold Metals Well-positioned to Secure Manono Project in the DRC
Kobold Metals, a mining company backed by Jeff Bezos and Bill Gates, is gaining traction in its bid to acquire a stake in the Manono lithium project in the Democratic Republic of Congo (DRC). Recent developments, including the visit of Massad Boulos, U.S. President Donald Trump’s Senior Advisor for Africa, to Kinshasa on April 2-3, 2025, signal growing U.S. interest in the DRC’s mining sector.
During his meeting with President Félix Tshisekedi, Boulos discussed strengthening bilateral ties through a potential “security for minerals” agreement to boost U.S. private sector investment, foster peace in the African nation, and preserve its territorial integrity. While details of the agreement remain unclear, Boulos confirmed progress toward a framework that could support American companies like Kobold Metals.
"I look forward to working with President Félix Tshisekedi and his team to stimulate US private sector investment in the DRC, particularly in the mining sector, with the shared goal of contributing to the prosperity of our two countries," he added.
Kobold’s proposal to develop the Manono deposit, which it describes as “a large-scale, long-term lithium mine,” comes as the DRC faces legal disputes over the project. Resolving these issues could help Kinshasa close its case with AVZ Minerals, in which state-owned Cominière was condemned to pay €39.1 million in penalties.
Further boosting Kobold’s position are recent U.S. tariffs targeting various countries, including Indonesia and China, both major players in the lithium battery supply chain. Washington’s recent measures could bolster American investment in the DRC as global demand for lithium continues to rise.
China-US Rivalry
The Democratic Republic of Congo (DRC) is emerging as a strategic player in the global race for critical minerals, with its 11% tariff for access to the U.S. market positioning it as an attractive alternative for American companies like Kobold Metals. Under the Trump administration’s new trade policies, this low tariff rate, combined with exemptions on several critical minerals—including cobalt, graphite, lithium, and tantalum, according to La Tribune—reinforces the strategic importance of investing in the DRC. As one of the world’s leading producers of these resources, the DRC holds significant leverage in negotiations.
Further strengthening Kobold Metals’ position is a proposed bill in the U.S. Congress aimed at curbing China’s dominance in Africa’s critical mineral supply chains. With Beijing controlling 80% of mining projects in the DRC, this legislative initiative aligns with broader U.S. efforts to counter China’s influence while promoting American investment in Africa’s strategic resources.
The DRC, however, has its own priorities. It seeks not only a militarily reliable ally but also greater participation in value chains tied to its mineral wealth, particularly as it advances its energy transition goals. The recent launch of a special economic zone (SEZ) dedicated to producing battery precursors and potentially assembling electric vehicles underscores Kinshasa’s ambition to capture more value domestically.
Competing with Rio Tinto
Competition for Manono’s lithium is intensifying. Anglo-Australian mining giant Rio Tinto has reportedly expressed interest in the deposit, adding pressure on the Congolese government to resolve disputes and capitalize on Western interest. This rivalry between Kobold Metals and Rio Tinto could strengthen Kinshasa’s negotiating position but also accelerate decision-making in a sector where China remains dominant.
For the Trump administration to secure deeper access for American investors, it will need to offer tangible guarantees that address Kinshasa’s economic and security concerns. In this geopolitical contest over African minerals, Manono’s lithium has become emblematic of the global competition for resources critical to the energy transition. How this plays out will depend on whether the DRC can balance its strategic objectives with mounting international interest in its mineral wealth.
This article was initially published in French by Georges Auréole Bamba
Edited in English by Ola Schad Akinocho
Kinshasa : reprise du trafic sur le boulevard Lumumba, principal accès à l’aéroport
À Kinshasa, la circulation a repris ce 7 avril 2025 sur le boulevard Lumumba, l’un des axes routiers les plus fréquentés de la capitale congolaise, après les fortes pluies qui se sont abattues entre vendredi et samedi derniers, provoquant d’importantes inondations, a constaté Bankable. Cette reprise a été rendue possible grâce à la baisse du niveau des eaux.
La veille, en raison de l’obstruction du boulevard Lumumba, principal accès vers l’aéroport international de N’djili, le seul de la capitale, de nombreux voyageurs ont dû recourir à des navettes fluviales, mises en place depuis le port de Beach Ngobila vers les ports de Kinkole ou Safari Beach, suivies de transferts en bus jusqu’à l’aéroport.
L’affluence a entraîné une flambée des prix. Certains voyageurs affirment avoir payé jusqu’à 150 dollars pour une place à bord d’un canot express. L’Office national des transports (ONATRA), qui a dénoncé « des pratiques tarifaires anormales observées chez certaines sociétés privées », rappelle que le tarif officiel est fixé à 20 dollars pour les grands bateaux et à 100 dollars pour les canots express.
À ce jour, de nombreuses habitations situées dans les zones les plus durement touchées par les inondations restent encore submergées, rendant leur accès particulièrement difficile. Faute de solution de relogement immédiate, plusieurs familles sinistrées y sont toujours coincées, dans l’attente d’une aide des autorités ou d’une décrue complète.
Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, a présenté un premier bilan de la catastrophe. Selon lui, les intempéries ont causé à ce jour 30 décès et une vingtaine de blessés. Entre inondations et éboulements, 5 000 familles auraient été affectées, dont seulement un millier a déjà été pris en charge, notamment au stade Tata Raphaël, en cours d’aménagement pour accueillir les victimes.
Ronsard Luabeya, stagiaire
Lire aussi :
Kinshasa : des morts et des dégâts matériels recensés après des pluies diluviennes
Lithium de Manono : terrain favorable à Jeff Bezos et Bill Gates
Des facteurs favorables à l’ambition de Kobold Metals société minière soutenue par les milliardaires américains Jeff Bezos (Amazon) et Bill Gates (Microsoft) d’acquérir une participation significative dans le projet de lithium de Manono, en République démocratique du Congo (RDC), s’accumulent.
Le dernier signal en date est venu de la visite officielle, les 2 et 3 avril 2025, à Kinshasa, du nouveau conseiller principal pour l’Afrique du président américain Donald Trump. À cette occasion, Massad Boulos a rencontré le président de la RDC, Félix Tshisekedi. Selon l’ambassade des États-Unis en RDC, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat bilatéral, notamment à travers la négociation d’un accord sur les minerais essentiels, la stimulation des investissements du secteur privé américain en RDC, et la coopération avec d’autres partenaires pour promouvoir une paix durable dans l’est du pays, dans le respect de l’intégrité territoriale de la RDC.
À sa sortie d’audience avec le chef de l’État congolais, Massad Boulos a déclaré aux médias que l’administration Trump avait pris connaissance de la proposition congolaise en faveur d’un accord « sécurité contre minerais ». Il a indiqué qu’un consensus avait été trouvé avec Félix Tshisekedi sur une « voie à suivre » pour l’élaboration de cet accord, sans en préciser les contours. « Je me réjouis de collaborer avec le président Félix Tshisekedi et son équipe pour stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, dans l’objectif commun de contribuer à la prospérité de nos deux pays », a-t-il ajouté.
Le conseiller principal du département d'État pour l'Afrique, Massad Boulos, a rencontré le président Tshisekedi aujourd'hui à Kinshasa pour discuter des moyens de renforcer notre partenariat bilatéral et de rendre nos deux pays plus prospères, notamment en travaillant à un… https://t.co/QnHrI6dhy2
— U.S.Embassy Kinshasa (@USEmbKinshasa) April 3, 2025
Dans ce contexte de négociations ouvertes avec les États-Unis autour d’un accord « sécurité contre minerais », il sera difficile pour Kinshasa d’ignorer l’offre de Kobold Metals concernant le développement du gisement de Manono, que l’entreprise décrit comme ayant « le potentiel de devenir une mine de lithium à grande échelle et de longue durée ». D’autant plus que la proposition de Kobold pourrait également permettre à la RDC de clore le litige avec AVZ Minerals une procédure dans laquelle la société publique Cominière a déjà été condamnée à verser 39,1 millions d’euros de pénalités pour non-respect d’injonctions judiciaires.
Par ailleurs, la récente décision des États-Unis d’imposer de nouveaux droits de douane crée un contexte encore plus favorable aux investissements américains en RDC. Ces droits visent plus sévèrement des pays comme l’Indonésie ou la Chine, deux acteurs majeurs de la chaîne de valeur des batteries au lithium.
Rivalité Chine-Etats-Unis
La RDC, dont les droits de douane pour l’accès au marché américain ne s’élèvent qu’à 11 %, pourrait ainsi devenir une alternative privilégiée pour des entreprises américaines comme Kobold Metals, renforçant le caractère stratégique de cet investissement pour les États-Unis. De plus, l’administration Trump a explicitement exempté plusieurs minerais critiques des nouvelles taxes. Selon un article publié par La Tribune le 3 avril 2025, cette liste inclut notamment le cobalt, le graphite, le lithium et le tantale autant de ressources dont la RDC est l’un des principaux producteurs mondiaux.
Enfin, une proposition de loi déposée récemment au Congrès américain, visant à limiter la présence chinoise dans les chaînes d’approvisionnement de minerais critiques en Afrique, constitue un autre facteur favorable à Kobold Metals. Dans un contexte de rivalité économique croissante avec Pékin, une telle initiative législative pourrait trouver un large soutien et contribuer à renforcer l’accompagnement institutionnel des investissements américains dans les ressources stratégiques africaines.
L’évolution de ce dossier reste à suivre, et plusieurs éléments seront déterminants pour définir l’orientation que prendront les autorités congolaises face à la proposition de Kobold Metals. Dans la logique américaine, il s’agit d’explorer et d’extraire des minerais critiques pour ensuite les transformer sur le sol national, créant ainsi des emplois aux États-Unis. La RDC, quant à elle, cherche à s’appuyer sur un allié militairement solide, tout en renforçant sa participation aux chaînes de valeur liées à ses minerais stratégiques, essentiels à la transition énergétique.
Rio Tinto en embuscade
Il y a quelques jours, le pays a d’ailleurs lancé les travaux d’aménagement d’une zone économique spéciale (ZES) dédiée à la production de précurseurs de batteries, de batteries elles-mêmes, et potentiellement à l’assemblage de véhicules électriques.
Par ailleurs, l’intérêt pour le lithium de Manono ne se limite pas à Kobold Metals. Des informations récentes indiquent que le géant anglo-australien Rio Tinto a également manifesté son intérêt pour ce gisement. Cette concurrence entre acteurs occidentaux pourrait renforcer la position de négociation de la RDC, mais aussi accentuer la pression sur le gouvernement congolais pour débloquer rapidement ce dossier, dans un contexte où la Chine contrôle actuellement 80 % des projets miniers du pays.
L’administration Trump, réputée pour ses positions fermes dans les négociations, devra néanmoins proposer des garanties concrètes pour convaincre Kinshasa d’ouvrir davantage son secteur minier aux investisseurs américains. Dans ce grand jeu géopolitique autour des minerais stratégiques africains, le lithium de Manono s’impose peu à peu comme un symbole de la nouvelle compétition mondiale pour les ressources de la transition énergétique.
Georges Auréole Bamba
Lire aussi :
Exportations vers les États-Unis : la RDC avantagée par les décisions de Trump
Accord minerais contre sécurité : Tshisekedi annonce des avancées avec les États-Unis
États-Unis : une proposition de loi pour bloquer le cobalt congolais raffiné par la Chine
Batteries pour véhicules électriques : le soutien américain à la RDC incertain avec Trump
Conflit à l'est de la RDC : Faure Gnassingbé prêt à reprendre la médiation de l’UA
Le président togolais Faure Gnassingbé est pressenti pour devenir le nouveau médiateur de l’Union africaine (UA) dans la crise persistante à l’est de la République démocratique du Congo (RDC). La proposition, formulée par le président angolais João Lourenço, président en exercice de l’UA, a été entérinée par le Bureau de l’Assemblée lors d’une réunion virtuelle tenue le 5 avril 2025.
Après avoir annoncé son retrait en tant que médiateur, comme l’indique un communiqué officiel de l’UA, le chef de l’État angolais a proposé Faure Gnassingbé pour lui succéder. Cette proposition a obtenu une réponse favorable du président togolais. Il ne reste plus qu’elle soit entériné par l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement.
La diplomatie togolaise a rapidement réagi à cette annonce. « Nous remercions le Bureau de l’Assemblée de l’Union africaine, et particulièrement le président Lourenço de l’Angola pour sa proposition, et confirmons la disponibilité du président Faure Gnassingbé à œuvrer pour la paix, la réconciliation et la stabilité dans l’est de la RDC », a déclaré Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, sur le réseau social X (anciennement Twitter).
Le Togo, sous la direction du président Faure Gnassingbé, s’est déjà illustré par son rôle dans la résolution de plusieurs crises en Afrique de l’Ouest. Grâce à sa médiation, 49 militaires ivoiriens détenus au Mali ont pu être libérés, évitant une escalade des tensions entre Abidjan et Bamako. Lomé a également contribué à apaiser les crispations régionales liées au retrait des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Pour Lomé, ce rôle de médiation représente non seulement une nouvelle mission diplomatique d’envergure, mais aussi une consolidation supplémentaire de son statut géopolitique. Dans un contexte marqué par les tensions régionales, mais aussi par l’émergence de nouvelles alliances panafricaines, le Togo renforcerait sa position comme carrefour diplomatique, logistique et stratégique en Afrique de l’Ouest. Cette mission pourrait également générer des retombées concrètes en matière de coopération bilatérale et de sécurité frontalière.
Faure Gnassingbé devra toutefois composer avec la présence d’autres médiateurs, notamment le Qatar. Doha a récemment marqué des points sur la scène diplomatique en parvenant à organiser une rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi (RDC) et Paul Kagame (Rwanda), le 18 mars 2025. Le Qatar a également réussi à réunir, à Doha, des représentants du gouvernement congolais et ceux de l’AFC/M23, avec l’ambition d’aboutir à un cessez-le-feu durable.
Ayi Renaud Dossavi, TogoFirst
Lire aussi :
Conflit à l’est de la RDC : cinq anciens chefs d’État nommés facilitateurs
Conflit à l’est de la RDC : l’Angola se retire des efforts de médiation
Conflit à l’est de la RDC : l’espoir de paix qui vient du Qatar
Kinshasa : des morts et des dégâts matériels recensés après des pluies diluviennes
De fortes pluies se sont abattues sur la capitale congolaise et ses environs les 4 et 5 avril 2025, causant d’importants dégâts humains et matériels. Plusieurs quartiers ont été inondés, alors que la rivière N’djili est sortie de son lit, submergeant des habitations et des infrastructures.
La montée soudaine des eaux a touché de nombreuses zones densément peuplées, causant plusieurs décès et endommageant de nombreuses infrastructures locales, selon plusieurs sources concordantes. Près de 14 communes de Kinshasa sont d’ailleurs privées d’électricité et d’eau potable, en raison des inondations qui ont affecté les installations de la Société nationale d’électricité (SNEL) et de la Régie de distribution d’eau (REGIDESO).
Une partie de la voirie urbaine a également été endommagée ou obstruée par des véhicules abandonnés sur les chaussées, provoquant d’importants embouteillages et transformant l’accès à l’unique aéroport de la ville en un véritable calvaire. Face à cette situation, le ministère des Transports a annoncé la mise en place de « mesures exceptionnelles » visant à garantir la continuité des déplacements vers cette infrastructure stratégique.
Il s’agit de l’organisation de navettes fluviales assurées par l’Office national des transports (Onatra), au départ du Beach Ngobila à destination du port Congo Futur à Kinkole ou du port Safari Beach. « Une fois arrivés à ces ports, les passagers pourront être acheminés par les bus de la Transco jusqu’à l’aéroport de N’djili », précise le ministère.
En dehors de Kinshasa, les fortes précipitations ont également affecté la route nationale numéro 1 (RN1) au niveau de Kasangulu, dans la province du Kongo-Central. Des portions de cette artère ont été gravement endommagées, perturbant la circulation entre Kinshasa et Matadi, un axe vital pour le transport de marchandises entre la capitale et le principal port maritime du pays.
Pour l’instant, aucun bilan officiel des dégâts n’a encore été communiqué.
Le 5 avril, lors d’une itinérance dans la ville, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a appelé la population à la prudence et a promis un plan de riposte pour venir en aide aux sinistrés. À l’issue d’une réunion d’urgence avec le ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, il a annoncé que des travaux de réparation étaient en cours, avec un rétablissement prévu dans les 72 heures pour les infrastructures endommagées. Le gouvernement a, pour sa part, assuré que les équipes de l’Office des voiries et drainage (OVD) sont déjà mobilisées pour la réhabilitation de la RN1.
Kinshasa, mégalopole de plus de 20 millions d’habitants, est régulièrement confrontée à des inondations durant la saison des pluies. En février 2024, Médecins sans frontières, citant des données officielles, faisait état de 12 décès et 1 177 maisons détruites à la suite d’intempéries et de la crue du fleuve Congo. En décembre 2022, le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) rapportait qu’au moins 169 personnes avaient perdu la vie à la suite de pluies diluviennes.
Selon une étude publiée en avril 2023 par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ces inondations sont en grande partie dues au blocage des voies d’évacuation d’eau par des constructions anarchiques et des déchets solides, notamment les bouteilles en plastique.
Ronsard Luabeya, stagiaire
Lire aussi :
Kinshasa : la BEI prête à investir dans la lutte contre les inondations et les embouteillages
Exportations vers les États-Unis : la RDC avantagée par les décisions de Trump
Le 2 avril 2025, le président américain Donald Trump a annoncé l’imposition de nouveaux tarifs douaniers, qualifiés de « réciproques », sur les importations en provenance de plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo (RDC). Selon l’administration américaine, le taux de 11 % désormais appliqué aux produits congolais refléterait, comme pour d’autres pays, le niveau des barrières tarifaires que la RDC imposerait aux exportations américaines.
Cependant, cette justification repose sur une méthode de calcul particulière. Elle consiste à établir le déficit commercial des États-Unis avec un pays donné, à le diviser par la valeur totale des importations en provenance de ce pays, puis à diviser le résultat par deux pour obtenir le taux de douane appliqué. Si ce calcul donne un chiffre inférieur à 10 %, ou en cas d’excédent commercial, un taux plancher de 10 % est appliqué.
La RDC applique des droits de douane standards, conformes aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans mesures discriminatoires spécifiques à l’encontre des produits américains. Selon les données officielles, ces droits varient de 5 % à 20 % de la valeur du produit hors frais de transport et d’assurance, en fonction de la nature des marchandises. À ces droits s’ajoutent diverses taxes, dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui peut porter le coût total du dédouanement à plus de 44,7 % de la valeur du produit.
Opportunités
Ainsi, le taux de 11 % finalement appliqué reste globalement avantageux pour la RDC. Le pays d’Afrique centrale échappe en réalité à une tarification plus lourde, en raison de la faible valeur des échanges commerciaux avec les États-Unis et d’un excédent commercial modeste (96 millions de dollars en 2024).
Les États-Unis ne figurent pas parmi les principaux clients de la RDC, bien que les échanges soient en progression. Selon le Bureau du représentant américain au Commerce, en 2024, les exportations congolaises vers les États-Unis ont atteint 323,1 millions de dollars, enregistrant une hausse de 17,5 % par rapport à 2023. Ces exportations incluent principalement des minerais et des métaux, tels que le cobalt et le coltan, essentiels à l’industrie technologique américaine. Les exportations agricoles, notamment le café et le cacao, ont quant à elles généré 31,5 millions de dollars en 2022.
Dans ce contexte, l’imposition de droits de douane à 11 % pourrait même ouvrir de nouvelles opportunités pour la RDC, qui dispose d’importants atouts en matière de ressources naturelles.
Dans le secteur minier, qui représente la majeure partie des exportations congolaises, la RDC est soit moins taxée, soit soumise à un niveau similaire de taxation par rapport à ses concurrents. À titre de comparaison : le Chili et le Pérou sont soumis à un tarif de 10 %, la Chine à 54 %, l’Indonésie à 32 % et la Zambie à 17 %. Cette configuration pourrait permettre à la RDC de conserver sa position actuelle sur le marché américain, voire de gagner en compétitivité face à certains concurrents.
AGOA
Par ailleurs, certains minerais et métaux produits par la RDC ne sont pas concernés par ces nouveaux droits de douane. Selon la Maison-Blanche, les lingots d’or, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le cuivre, le bois de construction, les produits énergétiques, ainsi que les minerais non disponibles sur le sol américain, sont exonérés de ces nouvelles mesures tarifaires.
Dans le secteur agroalimentaire, la décision de Donald Trump pourrait également ouvrir des perspectives pour le cacao congolais sur le marché américain. Ce produit pourrait concurrencer celui des deux leaders mondiaux, la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui représentent à eux seuls 60 % de l’offre mondiale. Ces deux pays sont désormais taxés respectivement à 21 % et 17 %, contre seulement 11 % pour la RDC.
Ces nouveaux droits de douane interviennent alors que la RDC, comme de nombreux pays africains, bénéficie encore des avantages de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), une loi américaine promulguée en 2000 visant à faciliter l’accès des produits africains au marché américain, en supprimant les droits d’importation sur plus de 6 800 produits.
Cependant, l’entrée en vigueur immédiate des nouveaux tarifs douaniers, prévue pour le 9 avril 2025, soulève des interrogations sur la survie de l’AGOA, dont l’échéance actuelle est fixée au 30 septembre 2025.
Georges Auréole Bamba et Boaz Kabeya, stagiaire
Lire aussi :
États-Unis : une proposition de loi pour bloquer le cobalt congolais raffiné par la Chine
Accord minerais contre sécurité : Tshisekedi annonce des avancées avec les États-Unis
Marché américain : pourquoi la RDC conserve son accès sans droits de douane
Zlecaf : la RDC annonce la suppression des droits de douane sur 6 230 produits d’ici 2031
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), le gouvernement congolais prévoit de supprimer progressivement, d’ici à 2031, les droits de douane sur 6 230 produits importés en provenance des pays africains membres de cette zone. Seuls 209 produits, soit environ 3 % de la liste globale, resteront exclus de cette libéralisation tarifaire.
L’annonce a été faite le 3 avril 2025 par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, à l’issue d’une réunion technique du comité national chargé de la mise en œuvre de la Zlecaf, présidée par la Première ministre Judith Suminwa. Le ministre a précisé que les listes des produits concernés par la libéralisation tarifaire et ceux exclus, ont été élaborées en collaboration avec le secteur privé et transmises au secrétariat général de la Zlecaf.
Toutefois, ces listes n’ont pas encore été rendues publiques par le ministère du Commerce extérieur, ce qui empêche, à ce stade, d’identifier précisément les produits concernés par la suppression des droits de douane et ceux maintenus sous protection.
Cette réunion a également statué sur les conditions permettant à la RDC de tirer pleinement profit de son intégration à la Zlecaf. Pour le ministre Julien Paluku, le respect des règles d’origine constitue une condition essentielle pour bénéficier de la libre circulation des biens au sein de la zone. Il précise qu’un produit ne pourra être exempté de droits de douane que si au moins 70 % de ses composants proviennent d’un pays membre de la Zlecaf.
Le gouvernement congolais mise également sur les zones économiques spéciales (ZES) pour tirer parti de cette intégration continentale. Ces zones sont conçues pour stimuler l’industrialisation, attirer les investissements étrangers et favoriser la diversification économique, dans l’objectif de renforcer le commerce intra-africain.
Toutefois, la mise en œuvre de la Zlecaf en RDC soulève plusieurs défis structurels qui vont au-delà des seules questions tarifaires. Julien Paluku a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures — routes, chemins de fer, centrales hydroélectriques — indispensables pour améliorer la compétitivité du pays sur le marché continental.
Ronsard Luabeya, stagiaire
Kinshasa : la SNEL annonce des travaux d’assainissement du réseau électrique
Au cours d’une interview diffusée par Radio Okapi le 27 mars 2025, le directeur du département de distribution de la Société nationale d’électricité (SNEL) à Kinshasa, Denis Alberic Tukuzu, a annoncé « pour bientôt » le démarrage des travaux d’assainissement du réseau électrique dans la partie nord de la capitale. Selon lui, ces travaux consistent à remplacer les infrastructures actuelles de distribution — dont certaines datent de l’époque coloniale — par de nouveaux équipements. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui à la gouvernance et à l’amélioration du secteur électrique en RDC (Pagase).
Ce projet est financé par un prêt de 135 millions de dollars accordé par la Banque africaine de développement (BAD) en mars 2017. Sa mise en œuvre devait initialement s’étendre sur trois ans. Pourtant, huit ans plus tard, les travaux n’ont toujours pas démarré sur le terrain, en raison de « lenteurs dans les acquisitions », selon un rapport d’évaluation publié en janvier 2024. Ce même document indiquait que le taux de décaissement des fonds n’était que de 1,15 %.
Dans le nord de Kinshasa, le projet prévoit la construction de 60 nouvelles cabines basse et moyenne tension, accompagnées de réseaux de distribution associés, ainsi que la modernisation de 35 cabines existantes d’une capacité de 630 kVA. Il comprend également le renforcement d’une sous-station 30/6,6 kV (15 MVA) et d’un poste 220/20 kV (100 MVA). Ces travaux devraient permettre de libérer une puissance de 140 MVA, suffisante pour alimenter environ 136 000 ménages, tout en améliorant les recettes de la SNEL.
Au-delà de la modernisation des réseaux de distribution à Kinshasa, le projet Pagase inclut également la réhabilitation du groupe 6 de la centrale hydroélectrique d’Inga 1, ainsi que l’extension de la centrale de Lungudi, avec la construction de Lungudi 2 (4 MW), dans la province du Kasaï, à proximité de la ville de Tshikapa.
Kinshasa, capitale de la RDC et centre d’affaires du pays, bénéficie de la meilleure couverture électrique nationale. Pourtant, la stabilité du réseau reste précaire, y compris dans des quartiers stratégiques comme la Gombe, cœur institutionnel de la capitale. Au-delà des déficits de production, Denis Alberic Tukuzu souligne les problèmes liés à la distribution, en particulier ceux causés par les réseaux installés avant 1960, aujourd’hui vétustes et inadaptés à la demande croissante, alimentée par la forte croissance démographique de la ville.
Ces dysfonctionnements du réseau ont des conséquences économiques directes, en particulier pour les commerces de denrées périssables et les petites entreprises dont l’activité dépend d’une alimentation électrique stable, comme les cybercafés.
Timothée Manoke, stagiaire
Lire aussi :
Électricité : la production de la RDC en hausse de 303 GWh en 2024, mais des défis persistent
Électricité : la SNEL perd 46 % de sa production à cause de la vétusté du réseau et de la fraude
Électricité : vers une restructuration de la dette de la SNEL, évaluée à 3 milliards $
CMOC en quête de sous-traitants pour des travaux électriques à Kisanfu et Koni
La société China Molybdenum Co., Ltd. (CMOC) a lancé, le 2 avril 2025, un appel d’offres pour sélectionner des entreprises chargées de réaliser des travaux électriques dans les localités de Kisanfu Gare et Koni, situées dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo (RDC). Les travaux prévus comprennent la construction d’une ligne moyenne tension interne de 2,5 km en 11 kV, la création de réseaux basse tension et l’installation d’un système d’éclairage public.
Les entreprises intéressées ont jusqu’au 7 avril 2025 pour soumettre leur candidature. Les dossiers doivent inclure les documents attestant de leur conformité aux exigences légales et financières, ainsi que des références prouvant leur expérience dans des projets similaires.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du développement du projet minier de Kisanfu, acquis par CMOC en décembre 2020 pour 550 millions de dollars auprès de Freeport-McMoRan. Le gisement est reconnu pour ses importantes ressources en cuivre et en cobalt, deux minerais clés dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques.
CMOC est un acteur majeur dans le domaine de la sous-traitance en RDC. En 2024, selon un rapport partiel de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), le groupe a attribué, à travers ses mines de Tenke Fungurume et Kisanfu, plus de 985 millions de dollars de marchés aux entreprises locales, soit près de 50 % du volume global déclaré.
Boaz kabeya, stagiaire
Lire aussi :
Sous-traitance en RDC : plus de 2 milliards $ de contrats signés en 2024
Ivanhoe Mines Turns to Zambia Following Copper Success in DRC
On April 2, 2025, Ivanhoe announced it had secured exploration licenses covering 7,757 square kilometers in Zambia’s North West Province.
The newly acquired Zambian concession lies 230 kilometers northeast of Ivanhoe’s Western Forelands project in the DRC. The company emphasizes geological similarities between this area and copper-rich discoveries in the DRC, particularly at Kamoa-Kakula. Ivanhoe is betting on the continuity of the Central African Copperbelt, which spans both nations.
“Our entrance into Zambia marks an exciting new chapter in Ivanhoe Mines’ commitment to expanding our exploration footprint and testing the extent of the Central African Copperbelt…which is already the world’s largest and highest-grade sedimentary Copperbelt,” said Robert Friedland, Ivanhoe’s Executive Chairman.
The key question is whether Ivanhoe can replicate its DRC success in Zambia. At Kamoa-Kakula, Ivanhoe boasts an annual production capacity of 600,000 tonnes of copper, with plans to exceed 800,000 tonnes over time. Even if Zambia does not reach these figures, success there would diversify Ivanhoe’s copper production, which currently relies entirely on the DRC.
Ivanhoe Mines is poised to make significant progress on its Zambian concession in the coming months, with key preparatory steps underway. During the second quarter of 2025, the company plans to hire environmental consultants to draft an Environmental Management Plan (EMP), which will be submitted for approval to the Zambian Environmental Management Agency (ZEMA).
In parallel, Ivanhoe is analyzing aeronautical geophysical data from the concession to design a feed program using the tariff and Air Core drilling methods. This process will enable its team of geologists to conduct detailed mapping of the expansive licensed area, identifying initial targets for future diamond drilling. The results of these operations will provide critical insights into the concession’s resource potential, shaping Ivanhoe’s exploration strategy and investment decisions.
This article was initially published in French by Emiliano Tossou
Edited in English by Ange Jason Quenum